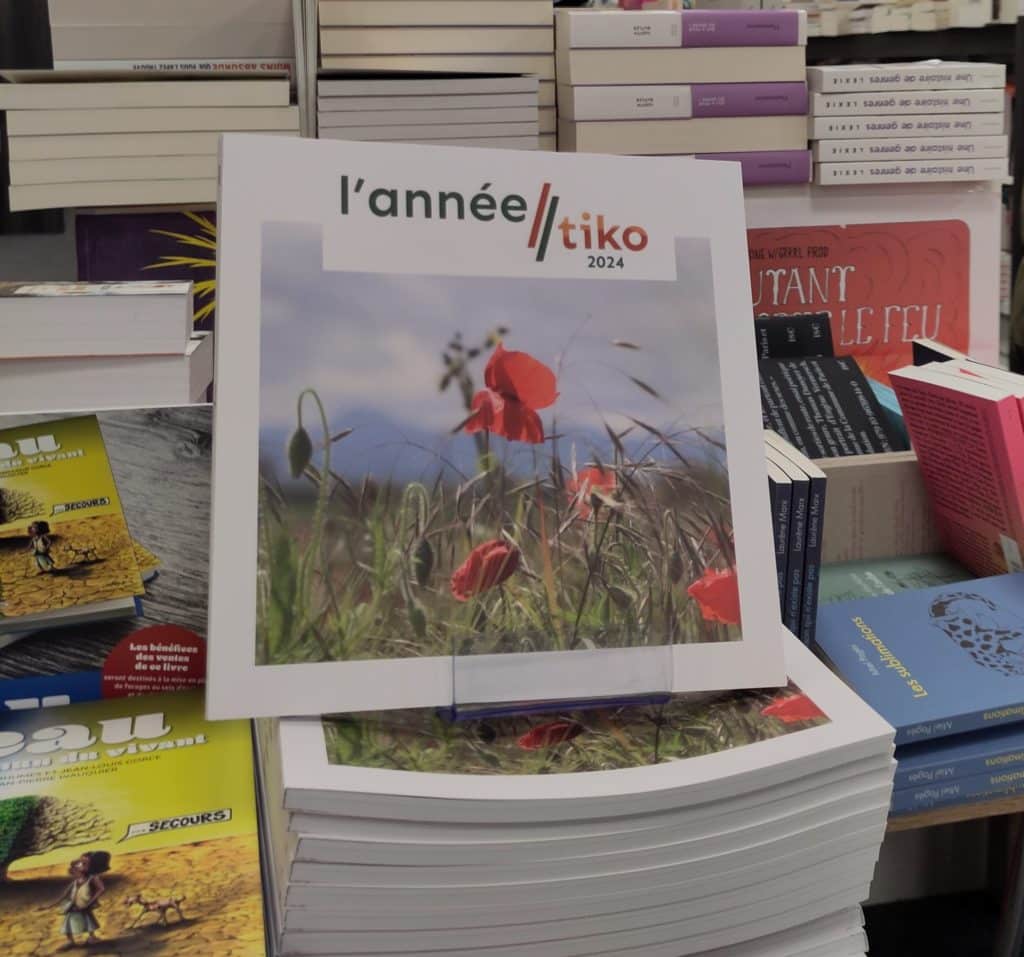Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]
Pour clôturer ma série champêtre, voici une initiative nationale, mais où le Puy-de-Dôme a été un contributeur particulièrement volontariste. Elle m’a paru intéressante à mettre en valeur, car s’il est bien un sujet sur lequel les consommateurs, aussi exigeants soient-ils, sont perdus, c’est bien sur la multiplication des labels ou des pseudo-labels et sur la crédibilité à leur accorder.
Alors pourquoi pas se fier à un label qui cocherait vraiment toutes les cases ?
Pour cela, il faut qu’il grandisse et que les agriculteurs bio s’en emparent. Pour cela il faut que les consommateurs les encouragent, réclament, insistent. Et que la confiance et la bonne volonté s’installent.
Chiche qu’on s’y mette ?
Marie-Pierre
Trois infos express [cliquer pour dérouler]
- La Fédération nationale de l’Agriculture biologique (FNAB) crée un label mieux-disant qui prend en compte des critères sur le social et la biodiversité, et prochainement aussi de bien-être animal et d’adaptation au changement climatique. Cette initiative s’est appuyée sur l’expérimentation à l’échelle des filières et des groupes locaux. Dont Bio63 et la participation de quatre maraîchers puydômois qui ont testé la certification.
- Parmi ces quatre pionniers, Rémi Pilon, qui témoigne de cette expérience. Elle a été facile pour lui parce qu’il était déjà bien avancé sur les critères mis en avant. Mais pour autant, il souligne la grande exigence du cahier des charges et des critères retenus, dont le caractère mesurable permet à chaque agriculteur, dès la phase de diagnostic, de se situer.
- Un gros travail reste à faire pour développer les labellisations, faire connaître le label aux consommateurs et ajouter les briques restantes. La FNAB et Bio63 mettent progressivement en place des outils pour accompagner l’évolution auprès de leurs adhérents.
Depuis son installation en maraîchage et culture de petits fruits, Rémi Pilon cultive en bio. « Une évidence », confie-t-il sur sa ferme [voir article précédent]. Car cet ancien chercheur de l’Inrae a repris des terres de son grand-père armé de convictions solides. Évidemment sans pesticides, en laissant la nature prendre ses droits dans des haies anciennes ou des touffes de prairie naturelle.
A part autour des pommes de terre, inutile de chercher un sol nu dans ses cultures, où même les allées les plus fraîchement tondues n’ont rien d’une pelouse de golf. Les mares ont été aménagées avec une aide de France Nature Environnement. On y croise le sonneur à ventre jaune et l’agrion de Mercure, respectivement crapaud et libellule protégés et relativement rares, ou l’anémone pulsatille tout aussi surveillée par les botanistes. Des bleuets, des coquelicots. Des mantes religieuses à foison…

Ajoutez un strict arrosage goutte-à-goutte, des murets de pierre prisés de la petite faune. Et un labour superficiel, une fois par an, seulement dans les parcelles de maraîchage.
Avec de tels principes et méthodes, Rémi était un candidat parfait pour faire partie de la cohorte des pionniers pour tester le nouveau label de la Fédération nationale de l’Agriculture biologique (la FNAB). D’autant plus qu’il était déjà administrateur de sa déclinaison auvergnate, Bio63. Même si cette qualité n’était en rien un critère, il fallait quand même un minimum de volontarisme car le label en lui-même risque de ne pas apporter grand-chose avant un certain temps.
Laver plus blanc
Pour le comprendre, il faut reprendre aux origines de cette initiative. Le label AB étant piloté au niveau européen, la FNAB, qui fédère surtout les petits producteurs bio, n’en a pas la maîtrise. Hélène Cadiou, animatrice Bio63 notamment en charge de ce projet, le confirme : « En 2020, dans le contexte d’un développement important du label bio, le réseau FNAB avait l’impression qu’il perdait la main sur les critères du cahier des charges. Ceux-ci allaient dans le sens d’une régression ou de décisions en défaveur des positions que nous défendons. Le constat a amené à l’idée de créer un label bio+ pour mettre en avant les valeurs défendues par nos agriculteurs et par notre charte, pour montrer qu’on peut faire mieux et pour valoriser nos pratiques. »

Parallèlement, loin de chez nous, une initiative locale a servi d’élément déclencheur : « il y a eu un partenariat entre les groupes FNAB du Sud-Ouest et la marque de surgelés Picard pour construire un label qui puisse mettre en avant des produits équitables, poursuit Hélène. Car le label bio est construit uniquement sur des critères de techniques agronomiques, même si la FNAB a toujours défendu l’aspect équitable. Cela a constitué une première brique que la fédération a souhaité reprendre nationalement, en ajoutant progressivement d’autres critères : biodiversité, social, bien-être animal, et adaptation au changement climatique. »
Pourquoi cette volonté d’être mieux-disant ? Parce que les producteurs bio ont du mal à faire comprendre aux consommateurs que certains labels sont déjà plus intéressants que d’autres. Pourtant les agriculteurs labellisés AB poussent plus loin les critères environnementaux, sont contrôlés beaucoup plus strictement, régulièrement et indépendamment que d’autres et apparaissent plus crédibles que la plupart des autres…
« Nous sommes conscients que dans le label bio, il existe des points de critique. »
Rémi Pilon
Mais la plupart des gens ont encore du mal à les différencier, d’autant que tous ont encore des « trous dans la raquette », autrement dit des critères qui ne sont pas pris en compte : ceux que la FNAB souhaite aujourd’hui ajouter. « Nous sommes conscients que dans le label bio, il existe des points de critique. Il y a donc une volonté d’y répondre, de ‘laver plus blanc que blanc’ », confirme Rémi Pilon. Étant entendu, précise Hélène, que la demande de certification impose d’être déjà labellisé Agriculture biologique.
Les briques et la méthode
La FNAB a donc entrepris de travailler à l’ajout de nouveaux critères, en procédant progressivement, brique par brique. Et en commençant par celles qui semblaient les plus urgentes pour répondre aux attentes : la brique sociale et la brique biodiversité.
La brique équitable, par exemple, n’apparaît pas primordiale à la FNAB, car elle concerne les relations commerciales avec les distributeurs, alors que les adhérents de la fédération sont souvent organisés en vente directe. « Pour qu’ils puissent valoriser le label, il fallait avancer sur d’autres critères », explique Hélène, qui précise la méthode retenue : « la FNAB a eu la volonté de travailler avec les différentes filières agricoles et d’associer les agriculteurs à la définition et à l’expérimentation du cahier des charges. »
« Bio 63 a été un des groupes les plus volontaristes. »
Yanis Essaoudi-Carra
C’est alors que la fédération a fait appel aux associations locales. « Bio 63 a été un des groupes les plus volontaristes », souligne Yanis Essaoudi-Carra, chargé de mission filière à la FRAB Aura, l’échelon régional de la fédération, qui a aussi participé à ce processus d’expérimentation. C’était pour Bio63 un choix du conseil d’administration, qui s’est notamment traduit par du temps de travail dédié, puis par la présence de trois administrateurs sur les quatre maraîchers inclus jusqu’au terme de l’expérimentation dans le processus.
Allers-retours
Mais n’allons pas trop vite : avant cette dernière phase, dans le Puy-de-Dôme comme ailleurs, des groupes de travail constitués d’agriculteurs, de salariés de Bio63 et d’experts apportant des compétences spécifiques se sont réunis régulièrement pour travailler sur les critères, thème par thème, pour déterminer ce qui leur paraissait viable, pertinent… « Le travail de ces groupes était remonté au niveau régional, puis national, avec ensuite des allers-retours entre les différents niveaux pour validation, appropriation, consultation… », poursuit Yanis.
Après une première réflexion sur l’élaboration des critères de certification en 2020-2021, la FNAB a consacré l’année 2022 à former des certificateurs. Puis les agriculteurs volontaires ont été conviés à participer à l’expérimentation du processus.

Dans le Puy-de-Dôme, une quinzaine de fermes ont participé à la première phase de labellisation, consistant en un diagnostic de l’état initial. A la suite de ce diagnostic, quatre ont franchi le pas suivant qui consistait à participer au processus de labellisation. Tous sont principalement en maraîchage, dans des contextes différents : que ce soit la grande Limagne pour les deux autres administrateurs, Stéphane Léonard et Nathanaël Jacquet, le Livradois pour Guillaume Emin, récemment installé, ou l’est du Forez pour Rémi Pilon.
Le but était donc de parvenir à respecter autant que possible les 9 critères de la brique sociale et les 11 critères de la brique biodiversité.
La suite de votre article après une petite promo (pour Tikographie)

« Les imaginaires, médiation culturelle de la résilience territoriale »
Notre prochaine table ronde réunira des intervenant.es puydômois.es autour des « imaginaires » et de la manière dont ces représentations culturelles façonnent notre engagement
48ème Rencontre Tikographie, jeudi 10 avril 17-19h (au KAP) – tous publics, accès libre
Merci pour votre temps de cerveau disponible ! Le cours de votre article peut reprendre.
Des critères précis
Côté social, les exigences sont groupées en quatre catégories : garantir la juste rémunération de l’agriculteur ou l’agricultrice, donner un cadre pour faciliter le lien employeur-employé, être exemplaire, et enfin renforcer l’attractivité des métiers. Et côté biodiversité : favoriser la présence d’infrastructures agro-environnementales, développer des bonnes pratiques culturales, être exemplaire et développer ses connaissances par la formation continue.
« Certains critères apparaissent faciles à mettre en œuvre pour nos adhérents, car ils sont déjà inscrits dans notre charte. »
Hélène Cadiou
« Certains critères apparaissent faciles à mettre en œuvre pour nos adhérents, car ils sont déjà inscrits dans notre charte, comme le fait de ne pas employer de travailleurs détachés, explique Hélène Cadiou. Sur d’autres critères, il y avait à la FNAB la volonté d’être mieux disant par rapport au label AB, de façon à pouvoir valoriser le label. Par exemple, en interdisant les nouveaux OGM ou certains fertilisants controversés, pas encore interdits en agriculture biologique. Ou dans la définition d’une prairie considérée comme permanente après 10 ans sans la travailler alors que les critères existants sont à 5 ans. »

Les critères biodiversité, dans le détail, portent sur des éléments précis : sur la façon d’entretenir les haies, les bonnes pratiques de taille et de forme des parcelles, la diversification de l’assolement, la réduction du travail des sols, le couvert des sols… Tout cela avec des seuils chiffrés et des calculs différents selon les types de cultures…
« C’est tout l’intérêt du label, explique Rémi. La FNAB avait une charte qui donnait des orientations. Avec le label, on a des indicateurs précis qui permettent d’argumenter. »
Les bons calculs
De fait, souligne Hélène, les quatre agriculteurs puydômois qui sont allés jusqu’à la certification sont ceux qui en étaient déjà les plus proches dans leurs pratiques antérieures. Pour eux, il a été facile de franchir le pas. Mais Rémi tient à ajouter : « ce n’est pas parce que nous quatre avons obtenu le label facilement qu’il n’est pas exigeant. Et ce n’est pas parce que d’autres n’atteignent pas les critères qu’ils font du mauvais travail. Être en bio, c’est déjà bien. La charte FNAB indiquait l’esprit mais tant qu’il n’y avait pas de critères mesurables, c’était difficile de se situer. »
Rémi témoigne avoir coché facilement les critères biodiversité : « des haies, j’en avais déjà plus que nécessaire ! » Côté social, le pas a été facile à franchir aussi car il n’emploie pas de salarié. « J’ai fait la formation obligatoire sur le calcul du prix de revient mais à part ça, je n’ai pas eu grand-chose à changer pour entrer dans les critères », dit-il.

A la suite de cette formation, même s’il ne se rémunère pas encore le temps de rembourser les emprunts de ses investissements, il a fait l’effort de calculer ses prix en tenant compte du temps passé, y compris des coups de main de ses parents retraités qui vivent à proximité. « D’après mes calculs, j’étais déjà sur une juste rémunération et je n’ai pas augmenté mes prix, mais je sais que si je dois un jour salarier quelqu’un, ce sera possible économiquement », dit-il.
Faire un label qui a du sens
Les coûts d’un label mieux-disant peuvent en effet apparaître rédhibitoires dans le contexte actuel, et Rémi Pilon, dont on a vu le modèle atypique, pourrait apparaître comme un cas de figure exceptionnel, mais il s’en défend : « les trois autres participants y sont parvenus aussi », souligne-t-il. « Certes cela peut dans certains cas aboutir à des prix plus élevés, mais nous répondons par les coûts cachés de l’agriculture conventionnelle : dépollution, santé… », complète Hélène.
« Le label incite à mieux accompagner les salariés, par la mise en place d’un livret d’accueil, d’un plan de formation, de réunions d’équipe régulières… »
Hélène Cadiou
Elle souligne aussi les choix forts pour lesquels la FNAB a opté : « il y a eu des débats pour savoir si on mettait des critères suffisamment bas pour que tous les agriculteurs bio puissent les atteindre facilement, ou des critères qui vont assez loin pour avoir du sens. Finalement, c’est cette deuxième voix qui a été retenue. C’est important pour se distinguer comme un vrai label. »
D’autres enjeux ont également été inclus dans la réflexion, par exemple sur la nécessité de renforcer l’attractivité du métier, pour les exploitants comme pour les salariés. « Le label incite à mieux accompagner les salariés, par la mise en place d’un livret d’accueil, d’un plan de formation, de réunions d’équipe régulières… », précise Hélène.

Aujourd’hui, les quatre pionniers du Puy-de-Dôme – et 25 au total en France – sont labellisés depuis la fin de l’an dernier, mais il reste beaucoup à faire.
Bio63, comme la FNAB à son échelle, ont mis en place un accompagnement des agriculteurs qui veulent se lancer dans la certification. Et même développé un outil en ligne d’autodiagnostic pour une première évaluation : « un super outil pour progresser, même si on ne vise pas le label », témoigne Rémi.
Des enjeux à travailler
La prochaine étape va donc consister à développer la démarche. Notamment, pour le Puy-de-Dôme, parmi les quinze qui s’étaient engagés sur le diagnostic. « Beaucoup étaient encore trop éloignés des critères, il y a donc un enjeu à les accompagner ; d’autres n’avaient pas souhaité s’engager au départ mais ont changé d’avis entretemps », précise Yanis, qui insiste sur la démarche de progrès que représente le label, même une fois la certification acquise : « sur la brique sociale, il y a neuf critères en tout, mais seulement deux obligatoires la première année. De même sur la biodiversité, sur les 11 critères, trois jokers sont possibles sur les trois premières années. Et des obligations de continuer à se sensibiliser et se former ont été posées. »
« Sur cent clients, j’en ai peut-être deux qui m’ont questionné à ce sujet. »
Rémi Pilon
L’enjeu de massifier les certifications est en effet important, y compris pour le rendre opérant auprès des consommateurs.
Rémi reconnaît qu’en l’état, le label ne lui est pas d’une grande utilité : « on a du travail à faire aussi auprès des consommateurs, mais c’est difficile tant qu’il y a peu de productions labellisées. J’affiche le label quand je suis sur les marchés, mais sur cent clients, j’en ai peut-être deux qui m’ont questionné à ce sujet. Il faut commencer par développer les labellisations, créer des incitations réciproques entre producteurs et consommateurs et arriver à faire que le label soit identifié et reconnu », dit-il, expliquant que d’autres motivations l’ont poussé à se lancer dans cette expérimentation : « l’envie de faire mieux, de montrer l’intérêt pour créer un effet d’entraînement et amorcer le mouvement, et aussi de répondre aux critiques et aux confusions sur les labels. »

Le projet n’en est donc qu’à ses débuts. Sans parler de la mise en place des autres briques, qui arriveront petit à petit.
En attendant, vous pouvez commencer à repérer le logo du label FNAB avec sa fleur blanche sur fond vert. Il est encore rare, mais il vous garantit le respect de vraies valeurs pour le présent et pour l’avenir, depuis les champs jusqu’à votre assiette.
Pour découvrir l'activité de Rémi Pilon, lire aussi le précédent article : « Pour adapter les cultures, Rémi Pilon expérimente des fruits bizarres »
| Pour découvrir l’activité de Rémi Pilon, lire aussi le précédent article : « Pour adapter les cultures, Rémi Pilon expérimente des fruits bizarres » Et pour en savoir plus sur le label, consulter la page dédiée sur le site de la FRAB. |
Reportage Marie-Pierre Demarty, réalisé le 15 et le 31 mai 2024. Photos Marie-Pierre Demarty, sauf mention contraire. A la une : sur la ferme de Rémi Pilon, des éléments très visibles entrant dans la brique biodiversité du label : haies, sols couverts, bandes de prairie naturelle…
Soutenez Tikographie, média engagé à but non lucratif
Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.
Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien : de l’adhésion à l’association à l’achat d’un recueil d’articles, il y a six façons d’aider à ce média à perdurer :
La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail
Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?
Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.