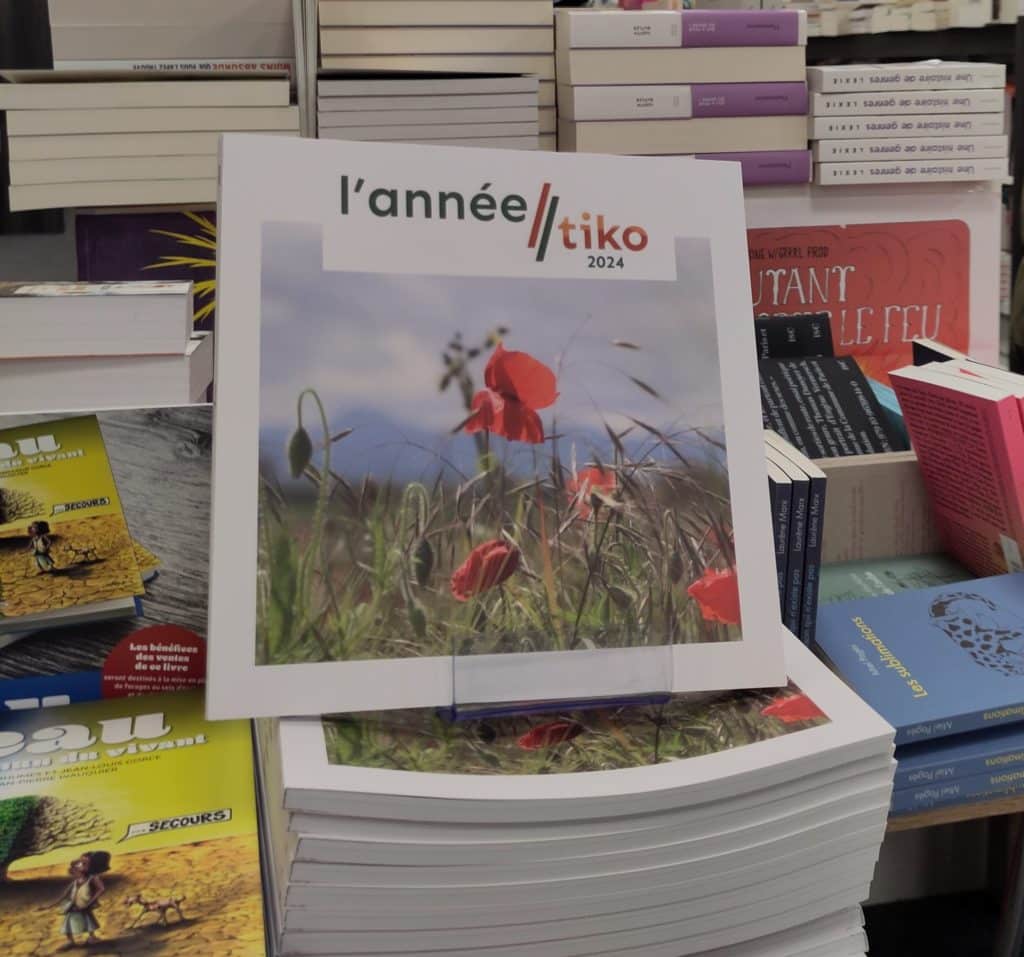Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]
On n’allait quand même pas laisser filer l’année du castor sans l’évoquer d’une façon ou d’une autre…
Cet article est du 2-en-1 : il nous parle à la fois d’une réussite en termes de restauration de la biodiversité – certes au sujet d’un animal qui s’accommode plutôt bien de la présence humaine, pourvu qu’on arrête de le prendre pour cible systématique – et de régénération des cours d’eau.
On a là un bel exemple d’action inspirée de la nature, agrégeant efficacité et quasi absence de ce qu’on appelle les externalités négatives. Quand une restauration de cours d’eau se fait classiquement par des travaux lourds, avec des engins qui peuvent faire des dégâts, sans compter leurs impacts liés à l’usage d’énergie fossile, ici, on pose juste quelques branches ici et là. Et si ça ne va pas, il reste facile de démanteler l’ouvrage et d’essayer autrement.
Quant au sujet de la qualité des cours d’eau, j’en parle certes assez souvent, parce qu’elle me semble centrale : elle touche aux questions de climat, d’agriculture, de biodiversité, d’alimentation en eau potable… Les cours d’eau charrient à la fois les symptômes et les causes de nombreux problèmes écologiques. Ils sont en quelque sorte les artères de nos territoires.
Cela vaut bien qu’on soigne le petit Charlet. N’est-ce pas, Dr Castor ?
Marie-Pierre
Trois infos express [cliquer pour dérouler]
- Le Charlet est un petit affluent de l’Allier, dans le Sud-Limagne, qui a été malmené par les humains, notamment pour des raisons agricoles : réduit à un fossé rectiligne, trouble, pollué et boudé par les truites. Même sa confluence avait été détournée. Le SMVVA a entrepris les premiers travaux pour le restaurer en 2019, à la hauteur où il atteint la forêt alluviale de l’Allier.
- En avril dernier, ce site a servi de support à un stage bien particulier : il s’agissait, pour des techniciens et autres professionnels de la rivière d’un peu partout en France, de s’initier à des techniques de restauration du cours d’eau low-tech, inspirées de celles des castors. Cette formation était menée notamment par deux spécialistes venus de Californie et par le philosophe Baptiste Morizot, auteur notamment de « Manières d’être vivant » et, plus récemment, d’un ouvrage sur le thème de cette alliance qu’il propose avec les castors, « Rendre l’eau à la terre ».
- Comme le suggère le titre de ce livre, le but de cette technique douce est de retenir l’eau dans les sols et dans les détours de la rivière, afin de favoriser la biodiversité et lutter contre la sécheresse. De fait, durant notre visite, nous avons observé des traces de divers mammifères revenus dans la zone : ragondins, loutres, ratons-laveurs. Et même – belle surprise ! – du castor en personne.
C’est un tout petit affluent de l’Allier, d’à peine 7 kilomètres de long – mettons 11 en comptant ses bras en amont qui s’assèchent facilement. Il a le malheur de s’écouler dans une zone peu pentue et très fertile : ce bout de la Limagne traversant Plauzat, La Sauvetat, Authezat et Corent, où l’homme a furieusement asséché, drainé, remembré, rasé, cultivé, fertilisé, pesticidé…
Résultat : le pauvre Charlet a été réduit à un fossé rectiligne, enfoncé et privé de son fond naturel caillouteux. Ce qui explique son aspect trouble. « À tel point qu’il colore l’Allier à l’endroit de la confluence. L’ancien maire d’Authezat l’appelait le fleuve jaune ! », souligne Aurélien Mathevon, technicien rivières du SMVVA (Syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon), qui veille sur les cinq affluents de l’Allier irrigant (principalement) la communauté de communes de Mond’Arverne.
Triste portrait
Aurélien, pour sa part, le qualifie d’« émissaire agricole » et se désole : « Autrefois, un peu en amont à hauteur de l’autoroute, il y avait un lac. Mais les zones humides avaient la réputation d’être insalubres et on les a drainées il y a longtemps. Aujourd’hui on voudrait les refaire artificiellement en créant des mégabassines. Ce n’est pas entendable ! »
« Un de mes challenges, ce serait d‘arriver à décolorer le Charlet. »
Et il achève, comme il dit, « le triste portrait du Charlet » en signalant le comble du comble : aujourd’hui, la petite rivière est alimentée en partie par l’Allier dans laquelle elle se jette, dont l’eau est pompée pour irriguer en amont, puis s’infiltre dans les sols, en se gorgeant au passage de nitrate et autres produits utilisés en agriculture conventionnelle, avant de s’écouler vers le drain principal du secteur. Ajoutez l’alimentation par la station d’épuration située à La Sauvetat – comme par hasard l’endroit où l’écoulement de la rivière devient permanent. « C’est une rivière complètement anthropisée, conclut Aurélien. Mon but, c’est de recréer des milieux naturels. Et un de mes challenges, ce serait, en améliorant sa qualité physique, morphologique et chimique, d’arriver à décolorer le Charlet. »
Ce chantier a un tout petit peu commencé, avec un reméandrage en amont sur une zone non agricole, et quelques aménagements dans le lit de la rivière pour lui donner une (faible) liberté de mouvement sans rogner sur les terres cultivées.

Un site pour un stage
C’est pourquoi, quand l’association ARRA² (ou Association Rivière Rhône-Alpes-Auvergne) a pris contact avec lui pour trouver un site où organiser une formation à des techniques de renaturation inspirées du castor, il lui a été facile d’orienter l’opération vers l’aval de la petite rivière. D’autant plus que le terrain avait été acquis antérieurement par le SMVVA, saisissant l’opportunité d’un propriétaire réticent aux travaux de renaturation, mais vendeur de la parcelle.
Ici, le Charlet a atteint la forêt alluviale de l’Allier, où l’ancien propriétaire avait planté des noyers et des peupliers en vue de les exploiter. Avant les premiers travaux, le cours d’eau rejoignait l’Allier par un « raccourci » pas très naturel, formant un confluent curieusement à contre-courant du cours d’eau principal. « En 2019, nous avons rouvert un ancien bras à la pelleteuse et fait gagner 400 mètres au Charlet », indique Aurélien. Objectif de cette opération quasi chirurgicale (et de celles qui suivent) : retenir les eaux le plus longtemps possible sur le territoire, notamment pour atténuer les effets des sécheresses. Tant qu’à faire, la forêt-plantation a été laissée en libre évolution, pour accueillir un maximum de biodiversité.

Et donc en avril l’an dernier, il s’est fait un plaisir d’accueillir le groupe de stagiaires auquel il s’est joint, et les prestigieux encadrants de la formation. En l’occurrence, le philosophe et naturaliste Baptiste Morizot, auteur du best-seller « Manières d’être vivant » et plus récemment d’un ouvrage sur les castors et sur la technique expérimentée dans le stage « Rendre l’eau à la terre », Suzanne Husky, artiste formée en agro-écologie, avec qui il a écrit ce dernier, ainsi que Kate Lundquist et Kevin Swift, les deux Américains auprès desquels ils se sont formés : ces deux pionniers de ces techniques douces de régénération des rivières sont arrivés tout exprès de Californie. D’autres techniciens motivés et engagés dans le Mouvement d’Alliance avec le Peuple Castor étaient également arrivés de différents coins de France pour y participer.
Méthode low-tech
« Le concept est de réhabiliter les cours d’eau par une méthode low-tech, en travaillant à la force de l’humain, de manière à imiter le castor. L’idée est de freiner l’eau et de rehausser son niveau en reconstituant le lit du ruisseau afin de lui donner la possibilité de créer des chenaux d’écoulement diversifiés, et d’amorcer des ouvrages, dans l’espoir qu’un jour les castors se réinstallent pour les entretenir et prolonger le travail », explique le technicien rivières local.
« Une construction manuelle en bois est facilement réversible. »
L’orientation low-tech, dans cette application, répond aussi à une vision de long terme : « Quand nos descendants ne disposeront plus d’énergie fossile et de machines puissantes, ils ne pourront pas détruire des barrages en dur, en béton ; alors qu’une construction manuelle en bois est facilement réversible. »
Neuf mois plus tard, nous visitons le site, accompagnés de Mélanie Aznar, chargée de mission du Groupe mammalogique d’Auvergne, elle aussi curieuse de voir le résultat, et précieuse pour lire les traces de la faune qui a manifestement saisi la perche tendue…

Besoin d’eau
Mais n’anticipons pas et découvrons le premier des petits ouvrages construits par le groupe en apprentissage, dont Aurélien nous commente les techniques et finalités, en ce mardi matin glacial de fin janvier.
« Le castor travaille avec la nature, alors que nous travaillons contre elle. »
« Ouvrage » est en effet le terme qu’Aurélien, se conformant à l’usage des naturalistes, préfère à celui de « barrage ». Car, comme nous le constatons ici, la construction n’arrête pas totalement l’eau mais la retient, la filtre, et complique son passage pour ralentir sa fuite vers l’Allier et vers l’Océan.
Mélanie précise que le castor « a besoin de faire monter le niveau de l’eau pour que l’entrée de son habitat soit immergée, inaccessible aux prédateurs. » Aurélien complète avec le besoin de créer des zones inondées au pied des arbres pour la même raison : « il peut s’attaquer aux troncs car il se sent en sécurité, il sait qu’il peut s’enfuir facilement. »

Il va donc surélever les ouvrages progressivement – « pour ne pas perturber trop brutalement les milieux » – jusqu’à inonder la forêt alluviale, créer des zones éponges qui stockent l’eau : leur version – combien plus naturelle et ouverte ! – de la mégabassine. « Le castor travaille avec la nature, alors que nous travaillons contre elle », commente Mélanie, ajoutant : « Il a aussi une influence sur la végétation : ces zones inondées permettent éventuellement d’éliminer des résineux plantés par l’homme qui n’ont rien à faire dans les forêts alluviales. »
Lasagnes
Sur place, Aurélien nous explique la technique : « On commence par des petites branches de 20 à 40 cm, plantées dans le sol pointe en bas. Puis on dispose des branches plus grandes et quelques poutres croisées. Entre les couches de bois, on ajoute de la terre, quelques gros cailloux. Et des ronces pour lier tout ça. En fait, on construit des lasagnes. »
« Le niveau est monté de 80 cm. »
Comme il le précise, le groupe s’est autorisé tout de même à utiliser la tronçonneuse et un enfonce-pieux thermique, mais globalement, les apprentis sont invités à « se mettre dans la peau du castor. »

L’ouvrage bâti par les stagiaires a ainsi créé un petit bassin en amont. L’eau passe, mais un bras supplémentaire, contournant deux arbres de la berge, s’est formé pour perturber le cheminement de l’eau. « Le niveau est monté de 80 cm », précise Aurélien.
S’approchant de la berge, Mélanie repère des traces de loutres et de ratons laveurs. « La vie se réinstalle », se réjouit-elle.

| Sur une autre réalisation du SMVVA pilotée par Aurélien Mathevon, lire aussi le reportage : « Le lac d’Aydat arbore pavillon bleu : remerciez la zone humide et le SMVVA » |
La suite de votre article après une petite promo (pour Tikographie)

« les sols en danger, pourquoi et comment les protéger«
Notre prochaine table ronde réunira des intervenant.es puydômois.es autour de la question des sols sur notre territoire : importance pour la biodiversité, l’eau, le climat, l’agriculture… et comment les régénérer
49ème Rencontre Tikographie, mardi 6 mai 17-19h (au KAP) – tous publics, accès libre
Merci pour votre temps de cerveau disponible ! Le cours de votre article peut reprendre.
Ouvrages d’art
Notre visite se poursuit vers l’aval, en suivant un sentier que le SMVVA a balisé de panneaux pédagogiques. Car le travail ne s’est pas arrêté à cette première réalisation. « Le castor construit plusieurs types d’ouvrages, dans une succession où certains sont destinés à en protéger d’autres, et dans le but de répartir l’eau », explique Aurélien.

Le bâti suivant imite ainsi un autre type de ralentisseur inventé par l’ingénieur aux dents longues. Il s’agit, à l’aide d’un muret de bois ne barrant qu’une partie du cours d’eau, d’obliger l’eau à le contourner, pour la contraindre à passer vers le bord et à creuser la berge, comme un micro-méandre. Celui-ci peut alors fournir des matériaux alluviaux, des cailloux qui viendront renforcer « l’armure » du lit pour limiter son enfoncement dans la nappe.
« Le castor construit plusieurs types d’ouvrages. »
Juste en dessous, le formateur américain a créé ce qu’il appelait, explique notre guide en prenant l’accent, un « porc-épic », grosse boule hérissée de pieux aux allures de sculpture contemporaine, ou plus sûrement, de hutte de castor. Une autre façon de contraindre la rivière à chercher son chemin dans le dédale pour la forcer à prendre son temps.

| Le SMVVA a un autre projet pour le Charlet, un peu plus haut en amont. J’en ai parlé dans l’article : « Bonnes nouvelles : sur le terrain, on ne lâche rien ! » |
Migration
Comme l’Allier s’écoule maintenant vraiment tout près, nous faisons un petit détour jusqu’à ses berges où Aurélien veut nous montrer pourquoi le site a été choisi : deux ou trois troncs ont été soigneusement grignotés, laissant des souches taillées en pointe de façon caractéristique. « Elles ont quelques années, sinon le bois serait plus clair, mais il est manifeste que des castors sont passés par là », explique-t-il.

J’en profite pour interroger Mélanie sur la présence du castor dans la région. « Il avait presque disparu de France, sauf quelques-uns sur le delta du Rhône. C’est le premier mammifère à avoir été protégé, puis il a été réintroduit dans les années 1970, pas en Auvergne mais sur la Loire, notamment dans l’Ecopôle du Forez. A partir de là, il s’est répandu sur le fleuve, puis est remonté peu à peu dans l’Allier. Il a recolonisé l’Auvergne à partir d’une souche de treize individus. Aujourd’hui il y est présent, mais pas en grand nombre. On en a recensé sur le Haut-Allier et sur la Dore, et à La Roche Noire, vers l’Ecopôle du Val d’Allier », explique-t-elle, en me montrant sur son téléphone la cartographie, déjà un peu dépassée, du riche « Atlas des mammifères d’Auvergne » consultable sur le site du GMA.
« Il a recolonisé l’Auvergne à partir d’une souche de treize individus. »
Elle en profite pour balayer au passage une idée reçue : « Le castor ne mange pas le bois, mais seulement l’écorce et les feuilles ; s’il coupe les troncs, c’est pour abattre les arbres, pour la construction mais d’abord pour atteindre les feuilles car il ne peut pas grimper. »
Des visiteurs !
Plus en aval, alors que nous atteignons les derniers aménagements imités du castor, Mélanie repère ce qui fait la joie de notre guide : un premier bâton méticuleusement taillé et écorcé, abandonné sur la rive, puis une grande branche traînant dans l’eau comme pour commencer à compléter le dernier petit barrage. « Ça a été fait récemment, et c’est sûr que c’est un castor. Un ragondin n’aurait pas taillé la pointe de cette façon », confirme-t-elle, en observant les traces laissées par les dents sur le biseau du bâton.

Pas encore installés sans doute, mais il semblerait qu’ils soient venus inspecter les lieux… Le coin ressemble d’ailleurs à une vraie place du marché. Mélanie y repère aussi des traces de passage de ragondins – dont ses caractéristiques crottes qu’elle surnomme des « cornichons » – et de ratons-laveurs. Aurélien repère sur le barrage les restes du pique-nique d’une loutre : petit tas d’arêtes et écailles, et juste à côté, des excréments à l’odeur caractéristique de poisson.
« Il n’y a pas que la pelleteuse : souvent on peut faire beaucoup plus simple. »
Des observations qui confirment que ces coups de pouce à la nature favorisent le retour de la biodiversité, et qu’« il n’y a pas que la pelleteuse : souvent on peut faire beaucoup plus simple », comme le conclut Aurélien, bien qu’étant parfois contraint d’utiliser cet outil invasif pour effacer des perturbations majeures des paysages et des écosystèmes.



Site à suivre…
Et maintenant ? Une nouvelle formation, ouverte elle aussi à des professionnels adhérents du réseau, va prochainement être organisée par l’ARRA², mais cette fois dans la Drôme où l’association dispose d’un site pilote qui a testé des modèles d’ouvrages plus importants.
Et ici sur le Charlet : « le site va rester un site d’expérimentation », assure Aurélien. Le sentier pédagogique, aménagé après l’achat du terrain, a été complété par des panneaux expliquant le projet. On peut y découvrir aussi, dans la ripisylve, les aménagements réalisés par le SMVVA, y compris une mare, ainsi que les ruines d’un ancien village dont seul un pigeonnier, belle silhouette fantôme au milieu des arbres, reste encore debout.


Par ailleurs, en partenariat avec l’Office français de la biodiversité, un suivi de l’évolution écologique du site est prévu. L’OFB avait, en préalable, procédé à un relevé du profil des berges et à un recensement des poissons, où seuls étaient présents les petites espèces de poissons blancs remontant de l’Allier.
On peut être assuré que le technicien rivière gardien des lieux va surveiller de très près l’évolution du site, avec au moins trois vœux pour le plus ou moins long terme : la transparence (au moins relative) des eaux du Charlet, la réapparition des truites sur ce petit cours d’eau, et une reprise des ouvrages à l’initiative des ingénieurs à queue plate, pourquoi pas jusqu’à dépasser le haut de la berge et s’écouler dans la forêt alluviale… et noyer ainsi le pied des arbres, riche ressource potentielle qui pourrait l’attirer. Est-ce trop demander ?
| Quelques ressources pour aller plus loi : > Sur le site du SMVVA, une présentation du stage d’avril 2024 et plus généralement, des missions du syndicat pour la gestion des milieux aquatiques. > Sur le site du Groupe mammalogique d’Auvergne, consulter notamment le très complet Atlas des mammifères d’Auvergne, déjà cité, avec un portrait détaillé de notre ami le castor (p. 256 à 260), et un complément actualisé ici. > Mélanie signale aussi le Réseau castor, initiative de l’OFB regroupant toutes les structures pouvant participer à l’observation et au suivi des populations de castors à l’échelle nationale, dont le GMA est adhérent, et par ailleurs ce récent article sur le castor dans le parc Livradois-Forez. > A découvrir enfin, le site (encore en construction) du Mapca ou Mouvement d’alliance avec le peuple castor, récemment créé à l’initiative de Baptiste Morizot et Suzanne Husky pour promouvoir ces pratiques de régénération low-tech des rivières. On y trouvera entre autres des vidéos sur le site pilote dans la Drôme. |
Reportage Marie-Pierre Demarty, réalisé mardi 28 janvier 2025. Photos Marie-Pierre Demarty (sauf mention contraire). A la une : Aurélien Mathevon, technicien du SMVVA, nous explique comment ont été élaborés ces premiers ouvrages low-tech sur le Charlet.
Soutenez Tikographie, média engagé à but non lucratif
Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.
Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien : de l’adhésion à l’association à l’achat d’un recueil d’articles, il y a six façons d’aider à ce média à perdurer :
La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail
Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?
Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.