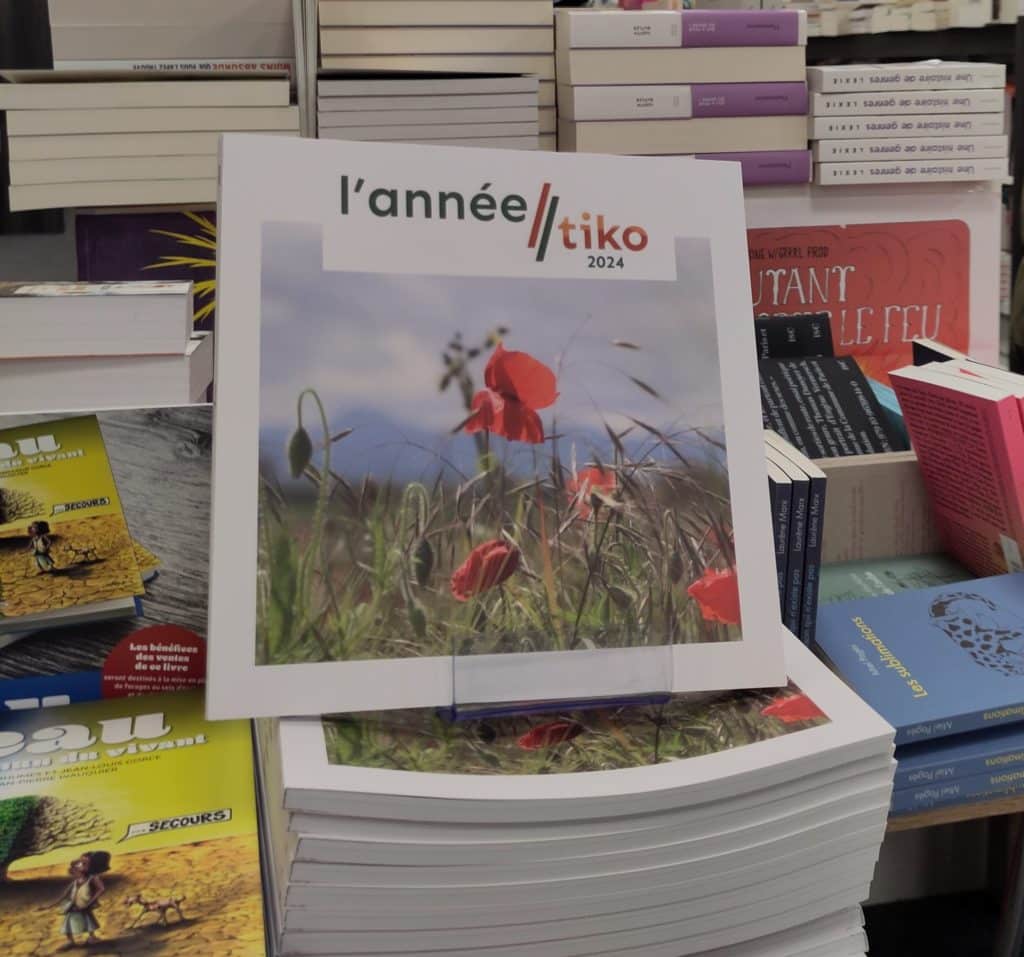Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]
Le sujet est d’actualité en permanence, tant il est crucial, mais on en reparle beaucoup depuis quelques mois à propos de ces polluants dits « éternels », les désormais fameux PFAS, dont on découvre non seulement la durée de vie, mais aussi l’étendue de leur présence dans tout ce qui nous touche de près : l’air qu’on respire, les aliments, les sols et… l’eau potable.
On ne sait pas exactement à quoi s’en tenir à ce sujet en Auvergne, et on n’est sans doute pas exposés ici aux mêmes risques que dans la « vallée de la chimie » de la région lyonnaise. Mais il semble important, pour préserver un territoire vivable, de comprendre comment nous est fournie l’eau de nos robinets, comment elle est traitée et garantie, en quantité comme en qualité.
C’est une petite question-test que j’aime bien poser quand j’échange avec des gens sur les problématiques environnementales : savez-vous d’où vient l’eau qui coule à votre robinet ? Au doigt mouillé (sous le robinet), j’ai la sensation que de plus en plus de gens sont en mesure d’y répondre, mais pas encore tant que ça…
D’où cette petite visite à Cournon, qui sera suivie en mars d’une table ronde sur le sujet dans le cadre de nos Rencontres Tikographie.
Marie-Pierre
Trois infos express [cliquer pour dérouler]
- La plus grande partie des habitants de l’agglomération clermontoise, soit 225 000 personnes, sont desservis en eau potable directement par Clermont Auvergne Métropole. La moitié de cette eau provient de la chaîne des Puys, en une multitude de points de captage. L’autre moitié est fournie par un unique champ captant qui prélève l’eau de la nappe alluviale accompagnant l’Allier. Ce champ captant est situé entre Cournon et Dallet.
- Les eaux provenant de ce dernier sont traitées dans une usine de production d’eau potable à proximité. Le site est centenaire, mais une nouvelle usine a été mise en service en 2016, pour pouvoir répondre aux problématiques chroniques ou accidentelles – crues et pollutions notamment – et sécuriser l’approvisionnement en eau potable. La consommation a cependant considérablement baissé depuis les années 1970, du fait de la délocalisation des industries et de la consommation plus raisonnée des ménages.
- La nouvelle usine est dotée d’une technologie de pointe, l’ultrafiltration. Son principe, simple et purement mécanique, permet d’éliminer les éléments indésirables jusqu’à la taille infime de 0,01 micron. Elle garantit une eau a priori de bonne qualité. Mais l’Agence régionale de santé n’a pas encore intégré à ses contrôles l’analyse générale des taux de PFAS, qu’elle est tenue d’effectuer d’ici à 2026.
Approvisionner une métropole comme Clermont en eau potable n’est pas une petite affaire. Imaginez les volumes pour qu’à tout moment de l’année, du jour ou de la nuit, l’eau puisse couler aux robinets – cuisine, salle de bain, toilettes et autres tuyaux d’arrosage – de près de 300 000 habitants, sans compter les bureaux et les usines, les administrations, les bâtiments publics…
Le nœud de cette organisation complexe se situe à Cournon, à environ un kilomètre au nord du plan d’eau, tout proche des berges de l’Allier. C’est là que se situe la principale usine d’eau potable gérée par Clermont Auvergne Métropole, que je vous emmène visiter.
Des sources et des nappes
Mais avant de comprendre ce qui se passe dans sa (très grosse) tuyauterie, il faut dézoomer pour comprendre d’où vient cette eau qui remplit votre gourde ou votre tasse de thé, nettoie votre linge et votre vaisselle, arrose votre jardin.
L’approvisionnement dépend de la zone où vous habitez. Pour une frange nord et une frange sud du territoire métropolitain, il est assuré par les syndicats voisins : ceux qui desservent une partie de la Limagne d’une part, et une vaste zone centrée sur le sud du département d’autre part. La Métropole dessert cependant la plus grande part de ses administrés, soit 225 000 habitants.

Et cela de deux façons. Pour la moitié ouest de l’agglomération, l’eau provient de captages disséminés prélevant sur diverses sources ou dans la nappe phréatique de la chaîne des Puys : une trentaine de points de prélèvement et de traitement, résultant de l’installation historique de l’eau courante, et de la nécessité de desservir notamment les points les plus hauts du territoire, en évitant au maximum de « remonter » l’eau par des systèmes de pompes coûteuses en énergie.
Pour l’autre moitié de la desserte, côté est, c’est plus simple. L’eau est puisée dans un unique et vaste champ captant qui s’étale sur 200 hectares le long de l’Allier, entre Cournon et Dallet, principalement sur la rive droite. Six « sous-stations » de pompage, reliées à un total de 68 puits de 13 mètres de profondeur, y prélèvent l’eau de la nappe d’accompagnement de la rivière : cette nappe alluviale constitue une sorte de prolongement du cours d’eau imprégnant les sols sableux qui encadrent son lit, et qui fonctionne avec la rivière en vases communicants.
Traitement centralisé
Toute la zone où est captée l’eau – et dans une moindre mesure ses alentours – est protégée strictement. Seul l’agriculteur-éleveur qui exploite ces terres, en bio évidemment, peut y pénétrer, ainsi que son troupeau, et encore avec quelques contraintes.
« Tout est automatisé. »
À partir de ces six sous-stations, l’eau est dirigée vers l’usine où son traitement est centralisé. J’y suis accueillie par Muriel Burguière, directrice du Cycle de l’eau de Clermont Auvergne Métropole, et Audrey Wawer, conseillère en environnement du même service.

Visiter cette usine consiste principalement en un échange autour d’un diaporama où s’accumulent les chiffres et les schémas très informatifs, et en une vision d’énormes machines en forme de tubes et de vasques qu’on ne découvre qu’à travers des baies vitrées. Ce qui peut être frustrant pour le visiteur, mais rassurant pour le consommateur : l’humain ne vient pas polluer ce qui est en train d’être soigneusement filtré et purifié.
« Tout est automatisé ; le site fonctionne avec dix agents, chargés surtout de la maintenance et de la surveillance », précise Audrey ; mais ils sont hébergés sur place, car l’usine est active sept jours sur sept et tourne le plus souvent la nuit.
| Sur un autre équipement géré par le service du Cycle de l’eau de la Métropole, lire aussi le reportage en deux volets : « Trois-Rivières 1/2 : comment fonctionne la station d’épuration de la Métropole ? » et « Trois-Rivières 2/2 : comment évolue l’assainissement à Clermont ? » |
Centenaire
L’équipement actuel est récent : sa mise en service date de 2016. Mais le site est beaucoup plus ancien puisqu’il est très exactement… centenaire. « L’usine a été construite pour faire face à la forte demande de l’industrie, déroule Audrey Wawer. L’eau était pompée brute, directement dans la rivière, et a commencé à être filtrée en 1928. »
« Ça a baissé quand les entreprises ont commencé à délocaliser les usines. »
Un premier chiffre spectaculaire est celui de l’évolution de la production : celle-ci s’élevait à 90 000 m3 par jour dans les années 1970 ; elle est ramenée aujourd’hui à 25 000 m3. « Ça a baissé quand les entreprises, et notamment Michelin, ont commencé à délocaliser les usines. Il y a eu aussi l’effet de la sensibilisation, et les progrès des appareils ménagers qui consomment moins d’eau », explique Muriel Burguière.
En passant par l’usine dans sa version actuelle, l’eau subit différents traitements qui vont la rendre potable, en différentes étapes. Suivons-la…
Premières étapes
Au premier stade, celui du traitement primaire, l’eau circule dans un bassin où elle est successivement minéralisée à l’eau de chaux, pour la rendre moins agressive pour les canalisations, éventuellement débarrassée de ses excès de fer et de manganèse – « mais ce n’est pas utile aujourd’hui, sauf dans les périodes de crues », précise Muriel Burguière – puis elle est débarrassée de différents polluants par un bain de barbotine : une poudre de charbon actif mélangée à de l’eau.
Cette substance poreuse absorbe les polluants dissous qui pourraient s’y trouver, tels que les hydrocarbures, les micropolluants, les perturbateurs endocriniens dont au moins une partie des fameux PFAS, ou les pesticides.



Une fois ce premier « tri » effectué, le deuxième stade va consister en deux étapes de filtration. La première, classique, élimine les plus grosses matières en suspens : graviers, cailloux et tout ce qui pourrait boucher les tuyaux.

Pailles, stéthoscopes et terrains de foot
La deuxième filtration, ajoutée à la construction de la nouvelle usine, est effectuée grâce à une technologie de pointe dite « ultrafiltration ». Audrey détaille le procédé : « Cette méthode permet de rendre l’eau ultrapure, en éliminant tout ce qui est plus gros que 0,01 micron, c’est-à-dire des bactéries, des algues, des pollens, des polluants, des virus… L’eau est envoyée dans des tubes qui sont des sortes de pailles filtrantes fonctionnant comme celles qu’on vend dans les magasins de sport pour pouvoir boire l’eau des rivières. »

Toutes les heures et demie, on envoie de l’eau dans ces pailles en sens inverse pour les nettoyer, et les boues retirées sont valorisées dans l’épandage agricole pour leur richesse en minéraux… mais de façon très contrôlée, précise Muriel Burguière, pour éviter de remettre dans la nature les polluants retirés de l’eau. Un nettoyage chimique est en outre effectué tous les dix jours, pour que ces pailles conservent leur capacité de filtration, précise-t-elle encore.
« Cette méthode permet de rendre l’eau ultrapure, en éliminant tout ce qui est plus gros que 0,01 micron. »
L’usine est équipée de sept « skids » rassemblant chacune un faisceau de ces pailles, « pour pouvoir les nettoyer par roulement, sans arrêter le processus », ajoute Muriel Burguière. Les amateurs de chiffres impressionnants noteront que la surface de membrane filtrante de l’ensemble de ces pailles, si on devait les ouvrir et les étaler côte à côte, représenterait 43 890 m², soit l’équivalent de sept terrains de football.

On relèvera aussi la simplicité astucieuse des procédures de surveillance de ces grosses machines : les agents les écoutent à l’aide de genres de stéthoscopes, puis baignent le skid dans l’eau pour repérer où est l’anomalie en fonction de l’air qui s’échappe, selon la bonne vieille méthode du pneu de bicyclette. « Ensuite, ils peuvent isoler la paille pour la réparer », précise Muriel.
La suite de votre article après une petite promo (pour Tikographie)

« les sols en danger, pourquoi et comment les protéger«
Notre prochaine table ronde réunira des intervenant.es puydômois.es autour de la question des sols sur notre territoire : importance pour la biodiversité, l’eau, le climat, l’agriculture… et comment les régénérer
49ème Rencontre Tikographie, mardi 6 mai 17-19h (au KAP) – tous publics, accès libre
Merci pour votre temps de cerveau disponible ! Le cours de votre article peut reprendre.
Distribution
Les dernières opérations du parcours permettront une désinfection finale au chlore, puis une deuxième reminéralisation par ajout de soude. Ensuite, l’eau sera « remontée » jusqu’au réservoir situé tout près, sur le puy de Bâne qui domine Cournon, à 460 mètres d’altitude. Et de là, il pourra desservir en gravitaire, c’est-à-dire sans pompage, toute la zone métropolitaine qui se situe au-dessous de ce niveau. L’eau sera distribuée en fonction de la demande, à travers les 1050 km de canalisations qui irriguent le territoire desservi directement par Clermont Auvergne Métropole.

« Le réservoir a une capacité de 40 000 m3, ce qui est rare en France, souligne Muriel Burguière. Ça s’explique par le fait qu’il était calibré pour les débits des années 1970. Mais c’est une chance, car en cas de problème, nous pouvons avoir une réserve de quelques jours, ce qui permet une gestion dans la sérénité. »
Les problèmes envisagés pour la fourniture en eau potable sont principalement de deux ordres : les crues et les sécheresses.
« En cas de problème, nous pouvons avoir une réserve de quelques jours. »
C’est précisément pour parer aux premières, ainsi qu’à des pollutions accidentelles ou à des problématiques chroniques, qu’a été construite la nouvelle usine. Elle permet par exemple, comme on l’a relevé, de faire baisser des taux anormaux de fer ou de manganèse, mais aussi de rallonger le procédé d’ultrafiltration par une filtration plus complexe dite « tangentielle » – d’où l’intérêt de pouvoir stocker davantage d’eau potable dans le réservoir, quand une crue est prévue, et permettre ainsi ce traitement de durée plus longue.
Faire face aux aléas climatiques
Muriel Burguière assure cependant qu’aucune inondation de grande ampleur, ni aucune pollution spécifique, ne sont venues jusqu’à présent perturber la marche habituelle de l’usine actuelle depuis sa mise en service, la dernière crue importante remontant à 2003. Mais la Métropole, sur cette question, est parée pour voir arriver les perturbations potentielles que pourrait amener le changement climatique.
« Au plus fort de la saison estivale, on descend à 18 000 m3 par jour au lieu de 25 000. »
Quant aux sécheresses, ce n’est pas au niveau du service du Cycle de l’eau qu’elles se gèrent. Mais il est pour autant concerné. Muriel Burguière relève que la demande en eau potable, de toute façon, baisse en été : « du fait que la fréquentation touristique ne compense pas les départs en vacances, au plus fort de la saison estivale, on descend à 18 000 m3 par jour au lieu de 25 000. »
Parce que l’eau potable est prioritaire parmi les usages en cas de restriction (juste après les besoins des milieux naturels) et du fait aussi du soutien d’étiage de l’Allier apporté par le barrage de Naussac, l’approvisionnement de la Métropole n’a pas rencontré de difficultés jusqu’à présent, même au cours de l’épisode très tendu des années 2022-2023.

| Sur le barrage de Naussac, lire le reportage en deux volets : « Vu du barrage #1/2 : c’est quoi au juste, Naussac ? » et « Vu du barrage #2/2 : Naussac face aux défis du changement climatique » |
Coopération
Cependant les difficultés de ces dernières années et la nécessité d’inclure dans la gestion de l’eau une solidarité des territoires pour répartir l’approvisionnement ont poussé à un rapprochement entre instances voisines responsables de l’eau potable. Une charte de coopération vient donc d’être signée entre Clermont Auvergne Métropole, le Syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Basse-Limagne (au nord) et le Syndicat mixte de l’eau de la région d’Issoire et des communes de la banlieue sud clermontoise (dont l’appellation précise suffisamment la situation géographique !).
« C’est une coopération à la fois politique et technique. »
Muriel Burguière décrypte cette charte : « Il s’agit de s’entraider en cas de problème. Par exemple, contrairement à nous, les deux syndicats mixtes n’ont pas la capacité de traiter les eaux en situation de crue importante. Nous pouvons aussi avoir des échanges et retours d’expérience sur les procédures de crise, sur la gestion de l’eau autant en cas de sécheresse que de crues, sur la tarification. Il n’est pas question d’aller jusqu’à une harmonisation des tarifs, mais au moins d’avoir une cohérence. C’est une coopération à la fois politique et technique. »
Analyses à compléter
Enfin, parmi l’évolution des risques à prendre en compte, les sujets de préoccupation sur les polluants et perturbateurs pour la santé sont de plus en plus prégnants dans l’actualité, et notamment les PFAS et les microplastiques.
Qu’en est-il pour l’eau des robinets clermontois ? « D’après nos analyses, ce n’est pas catastrophique et nous ne dépassons pas les normes règlementaires, explique la directrice du Cycle de l’eau. La filtration naturelle dans le champ captant et l’ultrafiltration dans l’usine permettent déjà d’éliminer beaucoup de polluants. Mais l’Agence régionale de santé n’a pas encore intégré à ses analyses la recherche systématique de PFAS. Elle est tenue de le faire à partir du 1er janvier 2026. On saura alors s’il y a lieu de mettre en place des mesures supplémentaires. »
« On saura alors s’il y a lieu de mettre en place des mesures supplémentaires. »
Outre les contrôles de l’ARS, le service métropolitain opère ses propres analyses de l’eau potable en plusieurs points de son parcours, depuis le prélèvement jusqu’à la distribution. Et veille en permanence à ce qu’elle soit potable, c’est-à-dire propre à emplir votre verre ou à alimenter votre douche du matin, à raison, dit la brochure de présentation de l’usine, d’une consommation moyenne par Français de 150 litres par jour.
Mais bien sûr, et même si le remplissage de Naussac grâce à une année 2024 (relativement) diluvienne permet de voir arriver l’été prochain sans inquiétude, les consignes de l’utiliser avec raison et parcimonie demeurent en permanence valables. Vous savez bien : les fameux « petits gestes » de couper l’eau quand on se brosse les dents, de prendre une douche plutôt qu’un bain, etc. Même s’ils ne représentent qu’une goutte d’eau dans l’océan de nos nécessaires transformations, ils ne sont pas à négliger !
Reportage Marie-Pierre Demarty, réalisé mardi 11 février 2025. Photos Marie-Pierre Demarty, sauf mention contraire. A la une : L’entrée de l’usine d’eau potable de la Métropole proche du champ captant du val d’Allier à Cournon.
Soutenez Tikographie, média engagé à but non lucratif
Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.
Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien : de l’adhésion à l’association à l’achat d’un recueil d’articles, il y a six façons d’aider à ce média à perdurer :
La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail
Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?
Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.