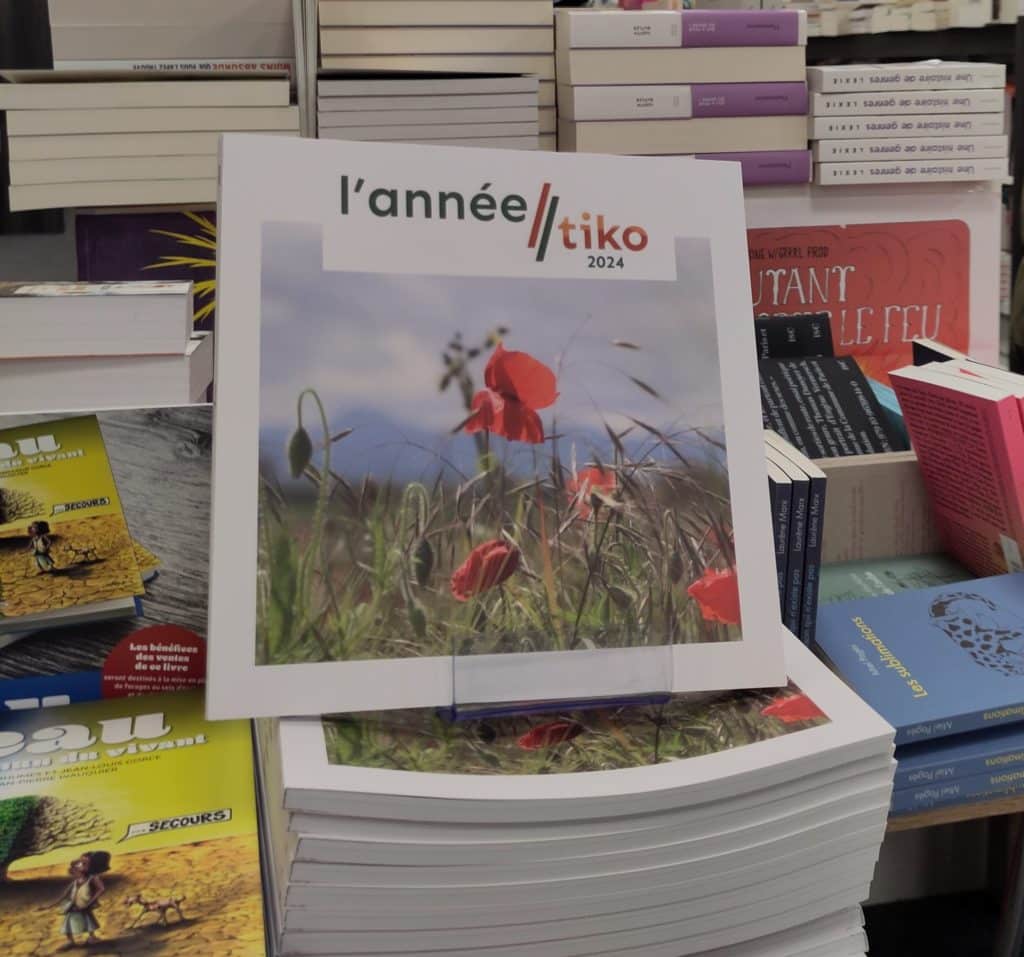Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]
Quoi de plus enthousiasmant qu’un projet qui se présente comme un trait d’union entre le passé du territoire et la construction de son avenir ?
Quoi de plus réjouissant qu’une promesse de redéployer des vergers dans le paysage ? de plus appétissant qu’une perspective de croquer la pomme locale, savourer les poires avec le fromage et ajouter des cerises sur le gâteau ?
Quoi de plus engageant que de poser les bases d’une autonomie alimentaire à reconquérir et celles de l’adaptation au changement climatique présent et futur ?
Quand un projet coche autant de cases – plus quelques autres – c’est peu dire qu’il fait sens. Et qu’on se doit d’aller l’explorer.
Marie-Pierre
Trois infos express [cliquer pour dérouler]
- Mond’Arverne est lauréat France 2030 pour développer un projet de démonstrateur agricole sur l’ensemble du Puy-de-Dôme. Baptisé Fruits de Dôme, ce projet a pour objectif de relancer la filière notamment arboricole, tombée en désuétude mais héritée d’une tradition locale autrefois très développée. Il s’intègre dans l’objectif de 50% d’autonomie alimentaire du PAT du Grand Clermont et du Livradois-Forez.
- Le projet est lauréat pour une première phase de 18 mois, dite de maturation, dotée de 300 000 euros. En s’appuyant sur diverses études et avec le concours de nombreux partenaires, il s’agit de construire un modèle économique viable et innovant. Si la démonstration est convaincante, Fruits de Dôme pourra être retenu pour une deuxième phase, d’expérimentation, pour 5 ans et une dotation de 6 millions d’euros.
- Parmi les défis à relever, deux problématiques ressortent fortement : celle de trouver du foncier pour installer des arboriculteurs et la nécessité d’avoir des bâtiments de stockage et de transformation à proximité des vergers. Il faudra résoudre aussi des questions de formation, de débouchés, d’adaptation au changement climatique….
On parle souvent de la complémentarité agricole de notre département entre les Limagnes céréalières et les montagnes d’élevage. Mais c’est oublier un peu vite un troisième milieu intéressant : les coteaux. Le dévers des failles, les buttes, les coulées et autres pentes aux expositions diverses de nos paysages familiers ont depuis les temps ancestraux fait de la Basse Auvergne une terre propice à l’arboriculture et à la vigne. « On oublie que la région approvisionnait autrefois Paris en fruits, vins et charbon », relève Pascal Pigot, président de Mond’Arverne Communauté.
Mais les mutations du XXe siècle ont presque complètement balayé cette vocation fruitière. Les petits paysans – ou leurs enfants – sont partis travailler chez Michelin ou dans d’autres usines ; l’urbanisation a grignoté sur les cultures ; les politiques nationales ont même encouragé l’arrachage des arbres à certaines périodes.
« On oublie que la région approvisionnait autrefois Paris en fruits, vins et charbon. »
À tel point que les surfaces de vergers ont été divisées par dix. « Il reste 191 hectares en production dans tout le département et environ 180 agriculteurs qui produisent des fruits, mais c’est pour eux une production parmi d’autres, souvent secondaire et en très petites surfaces », décrit Rémi Peyrat, recruté fin 2024 par la communauté de communes du sud clermontois pour animer, aux côtés de la responsable développement économique Sylvie Lavigne, le projet de relance de cette belle filière – projet joliment intitulé « Fruits de Dôme ».
Deux lauréats
Mond’Arverne est le territoire où cette initiative avait du sens : l’une des zones autrefois les plus productives en arboriculture, elle était déjà pionnière sur le sujet, avec quelques initiatives localisées : le tout premier verger-test à l’échelle nationale, installé dès 2016 en partenariat avec les associations Îlots Paysans et Terre de Liens, et plus récemment la constitution à Saint-Amant-Tallende d’une Association foncière agricole autorisée, menée par la municipalité, pour faire revivre le coteau de la Montagne de la Serre en associant amandiers et élevage de poules. Sans compter les initiatives plus anciennes, la présence de producteurs en activité, ou celle d’un ESAT producteur de jus de pommes à Veyre-Monton.
« C’était une des dernières chances de faire revivre l’arboriculture dans le Puy-de-Dôme. »
C’est pourquoi la communauté de communes a saisi l’opportunité de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de France 2030 proposant de financer des projets de « Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires ». « Nous connaissions la problématique grâce au verger-test ; il y avait des appétences à s’emparer du sujet et c’était une façon de contribuer à l’objectif du PAT [projet alimentaire territorial] du Grand Clermont et du Livradois-Forez, qui est de parvenir à 50% d’autonomie alimentaire d’ici à 2050 », explique Pascal Pigot. Et il ajoute, pour compléter l’exposé des motivations du projet, le mot de la directrice générale adjointe qui a piloté le dossier, Sophie-Caroline Fargues : « C’était une des dernières chances de faire revivre l’arboriculture dans le Puy-de-Dôme. »

Le dossier a donc été monté en 2023 et a été retenu, en avril 2024, parmi les 14 lauréats nationaux de cette « troisième vague » rejoignant les 15 désignés antérieurement. « C’est d’autant plus remarquable que deux projets ont été retenus dans le Puy-de-Dôme, l’autre étant porté par le PETR du Grand Clermont sur le sujet du pain. Cela souligne la qualité des dossiers locaux », souligne le président.
| Sur le projet à Saint-Amant-Tallende, lire aussi : « Un outil inédit, des amandiers et des poules pour valoriser la Montagne de la Serre » |
Partenaires multiples
L’autre fait remarquable, c’est que Mond’Arverne porte un projet… pour tout le Puy-de-Dôme. « C’était une évidence pour une question d’échelle. Le territoire pertinent était le département parce que celui de Mond’Arverne n’est pas suffisant pour développer une filière viable. Nous sommes chef de file du projet parce que nous en avons pris l’initiative et que personne ne nous l’a contestée, mais la notion d’inter-territorialité se développe de plus en plus et nous travaillons avec nos voisins et nos pairs, qui sont partie prenante », poursuit Pascal Pigot.
De fait, la réponse à l’AMI a été déposée au nom d’un consortium réunissant une dizaine de structures publiques ou privées, entourées de partenaires dont certains pourront s’impliquer davantage dans la deuxième phase du projet.
« Le territoire de Mond’Arverne n’est pas suffisant pour développer une filière viable. »
Parmi ces parties prenantes, on compte logiquement le Conseil départemental, mais aussi des acteurs aux compétences variées, tels que l’Inrae, la Safer, l’association Terre de Liens, la Chambre d’agriculture, Bio 63, le producteur de pâtes de fruit Cruzilles ou la commune de Saint-Amant-Tallende. Et bien sûr, les porteurs du projet ont d’ores et déjà empoigné leur bâton de pèlerin pour entrer en contact avec les autres communautés de communes potentiellement concernées, ou avec des agriculteurs, en différentes réunions pour présenter l’initiative et embarquer des volontaires.
Quel périmètre ?
Le territoire concerné est assez large. Même si intuitivement on peut imaginer qu’il n’y aurait pas de sens à cultiver des pommes sur les flancs du Sancy ou à défricher le Haut-Forez pour planter des abricotiers, le potentiel a été précisé avec le concours d’un autre partenaire, le Conservatoire d’espaces naturels (CEN), notamment pour définir les altitudes pertinentes. « Par exemple les amandiers peuvent être cultivés jusqu’à 600 m, mais on peut monter jusqu’à 850 mètres pour les myrtilles, explique Rémi Peyrat. A partir de ces données, j’ai réalisé une projection par rapport au climat futur, en me basant sur le scénario du GIEC à +4°C et en retenant trois indicateurs de données météo, suggérés par le CEN comme pertinents pour la production de fruits : le nombre de jours consécutifs à plus de 35°C, la date de la dernière gelée printanière, et le nombre de ‘jours d’été’ au printemps, c’est-à-dire à plus de 25°C entre avril et juin. »

Le résultat donne une cartographie qui tend à faire remonter les vergers en altitude par rapport aux anciennes plantations, et à écarter l’est de la Limagne, zone la plus chaude du département. « L’avantage du Puy-de-Dôme, poursuit Rémi, c’est qu’on a un panel de toutes les altitudes, de toutes les expositions et de tous les sols. »
Et de cette étude sont déduits les objectifs du projet, pour s’aligner sur ceux du PAT : « À l’échelle du département, nous avons le potentiel pour arriver à 50% d’approvisionnement local en fruits. Cela demande de multiplier les surfaces d’exploitation par quatre, à raison d’un rendement d’environ 12 tonnes par hectares, pour arriver à une production de 6000 à 7000 tonnes par an », précise le chargé de mission.
« On a un panel de toutes les altitudes, de toutes les expositions et de tous les sols. »
Pour l’heure, Fruits de Dôme n’a pas (encore) la vocation à mener à bien ce développement jusqu’à 2050, mais d’amorcer un déploiement, d’abord dans les 18 prochains mois. C’est l’échéance de cette première phase de l’AMI, dotée de 300 000 euros financés par la Banque des Territoires.
Modèles innovants
Durant cette phase dite de maturation, les porteurs du projet devront parvenir à proposer un modèle viable, chiffré et mûr pour une deuxième phase dédiée à l’expérimentation. Si la démonstration est convaincante, ils pourront être retenus pour bénéficier de cinq années de soutien supplémentaires, avec une dotation de 6 millions d’euros. Ce qui se solderait donc, si tout va bien, par un accompagnement de France Relance sur six ans et demi.

Avec le concours de l’Inrae, les retours d’expérience des producteurs et la participation de toutes les parties prenantes, cette première phase doit donc travailler sur toutes les facettes de la filière : études sur les variétés fruitières, possibilités d’installation, infrastructures de transformation, débouchés…
« Il ne s’agit pas de reproduire à l’identique les modes de production du XXe siècle, mais de réinventer un modèle, avec un maître-mot : l’innovation. L’idée est d’aller au maximum vers une agriculture respectueuse de l’environnement, de préférence bio, même si dans un premier temps on devra inclure aussi les modes de production simplement raisonnés. Mais toutes les expérimentations sont envisageables, par exemple sur l’agroforesterie, l’association avec la vigne, les types de conservation et de transformation… Il s’agit d’inventer un développement économique pérenne », indique Pascal Pigot.
« Il ne s’agit pas de reproduire à l’identique les modes de production du XXe siècle. »
Les premiers échanges avec le CEN, gestionnaire de plusieurs vergers conservatoires, ont ouvert encore d’autres perspectives de travail, notamment sur l’intégration de variétés locales adaptées au territoire, ou sur l’association, voire l’installation de pépiniéristes pour accompagner le développement de la filière.
| Sur le verger-conservatoire du CEN à Tours-sur-Meymont, lire aussi le reportage : « Grâce au verger conservatoire de Tours-sur-Meymont, la tradition fruitière locale reprend des couleurs » |
La suite de votre article après une petite promo (pour Tikographie)

« les sols en danger, pourquoi et comment les protéger«
Notre prochaine table ronde réunira des intervenant.es puydômois.es autour de la question des sols sur notre territoire : importance pour la biodiversité, l’eau, le climat, l’agriculture… et comment les régénérer
49ème Rencontre Tikographie, mardi 6 mai 17-19h (au KAP) – tous publics, accès libre
Merci pour votre temps de cerveau disponible ! Le cours de votre article peut reprendre.
Besoins de foncier
La « maturation » en cours s’appuie aussi sur d’autres études réalisées ou à entreprendre durant ces dix-huit mois. Ainsi la Chambre d’agriculture, avec le concours de Bio 63 et d’Auvabio, a réalisé un diagnostic sur le profil et les besoins des exploitants actuels. Une autre étude va porter sur le demi-gros et la vente directe, afin de mieux comprendre ce qui est consommé, par qui, et par quels canaux de distribution.
Parallèlement, le projet a été présenté à une trentaine d’agriculteurs et propriétaires de vergers, en trois réunions sur différents points du territoire, et un collectif d’exploitants a été constitué pour permettre des échanges, témoignages et apports à la construction des modèles.
Leurs premiers retours font apparaître notamment deux écueils importants que le projet devra prendre en compte : l’accès au foncier et le besoin de bâti agricole.

Concernant le premier sujet, le président de Mond’Arverne se réjouit d’avoir rallié la Safer au projet, car cet organisme qui oriente l’attribution des terres agricoles disponibles pourra prendre en compte les besoins liés au déploiement de Fruits de Dôme. Et il n’exclut aucune possibilité : « Le potentiel se trouve dans les transmissions de terre, les friches, la reconversion d’exploitations agricoles en vergers, le développement de l’agroforesterie qui peut en même temps constituer une solution pour faire face au changement climatique. Nous allons prospecter aussi auprès des propriétaires de parcelles favorables à l’arboriculture ; car il peut y avoir des possibilités d’achat de foncier par l’EPF (Établissement public foncier) pour y installer de jeunes agriculteurs. Et nous dialoguons aussi avec les quatre projets alimentaires territoriaux présents dans le département. »
Quand le PLUi tombe bien
La question du bâti vient encore compliquer les choses, car l’arboriculture nécessite des hangars de stockage, des frigos, des lieux de transformation proches des vergers, mais certaines zones agricoles, établies comme non constructibles dans les plans locaux d’urbanisme (PLUi), ne le permettent pas. « Cette difficulté fait écho aux injonctions gouvernementales des années 1960 et 1970, à l’époque du remembrement, et au schéma des représentations à l’échelle nationale, qui n’envisageaient que la grande culture et l’élevage. Il n’a pas été prévu de case pour l’arboriculture », fait remarquer Rémi.
Mais les révisions des PLUi en cours – dont celui de Mond’Arverne – pourraient apporter des débuts de solution. « Dans le cas de Mond’Arverne, nous avons dû revoir notre copie après l’avis des personnes publiques associées, avec 143 ha initialement prévus à urbaniser que nous devons convertir en non constructible. Bien sûr tout n’est pas plantable mais une partie de ces surfaces ont été orientées vers une classification en agricole constructible, en vue de favoriser des créations de vergers », expose Pascal Pigot.
« Il n’a pas été prévu de case pour l’arboriculture. »
Resteront encore de nombreuses questions à examiner. Par exemple celle de la formation à la culture fruitière, quasi inexistante dans la région. Ou celle des débouchés, pour laquelle le projet compte en premier lieu sur les besoins de la restauration scolaire et collective « qui peut en absorber beaucoup » et qu’il faudra intégrer à l’invention de nouveaux modèles. Au-delà, la demande peut concerner plus généralement la restauration hors domicile, ainsi que la distribution en vente directe, sur les marchés de producteurs qui se développent un peu partout, les Amap, etc.

Retours prometteurs
Beaucoup de pain sur la planche donc – heureusement agrémenté d’une savoureuse couche de compote ou de confiture – mais le projet s’engage sous de bons auspices, à en juger par les réactions et retours reçus depuis l’annonce des lauréats de l’AMI en avril dernier.
Le président de Mond’Arverne dit avoir été épaté par le potentiel de dynamisme et d’innovation dans des zones agricoles comme le Livradois. Rémi Peyrat se remémore les témoignages lors des réunions de présentation du projet, où s’est affirmée la volonté « de ne pas être concurrents mais complémentaires entre producteurs sur un tel projet. »
« Le nom est porteur. »
Il enregistre aussi les nombreux appels reçus de personnes ou structures intéressées : porteurs de projets d’installation, restaurateurs, collectivités… Des réactions prometteuses, pour ce démonstrateur qui se veut réplicable à terme.
Ce bel engouement a bénéficié d’une médiatisation pleine de sympathie. Mes interlocuteurs l’expliquent par l’image positive des fruits, par le caractère innovant du projet, par la mémoire du passé arboricole encore fraîche dans l’imaginaire local. Et peut-être aussi, avance Rémi dans un grand sourire, « parce que le nom ‘Fruits de Dôme’ est porteur. »
Reportage Marie-Pierre Demarty, réalisé mercredi 12 février 2025. Photos Marie-Pierre Demarty. A la une : un des rares vieux vergers subsistant sur le coteau de Monton, au cœur du territoire de Mond’Arverne.
Soutenez Tikographie, média engagé à but non lucratif
Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.
Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien : de l’adhésion à l’association à l’achat d’un recueil d’articles, il y a six façons d’aider à ce média à perdurer :
La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail
Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?
Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.