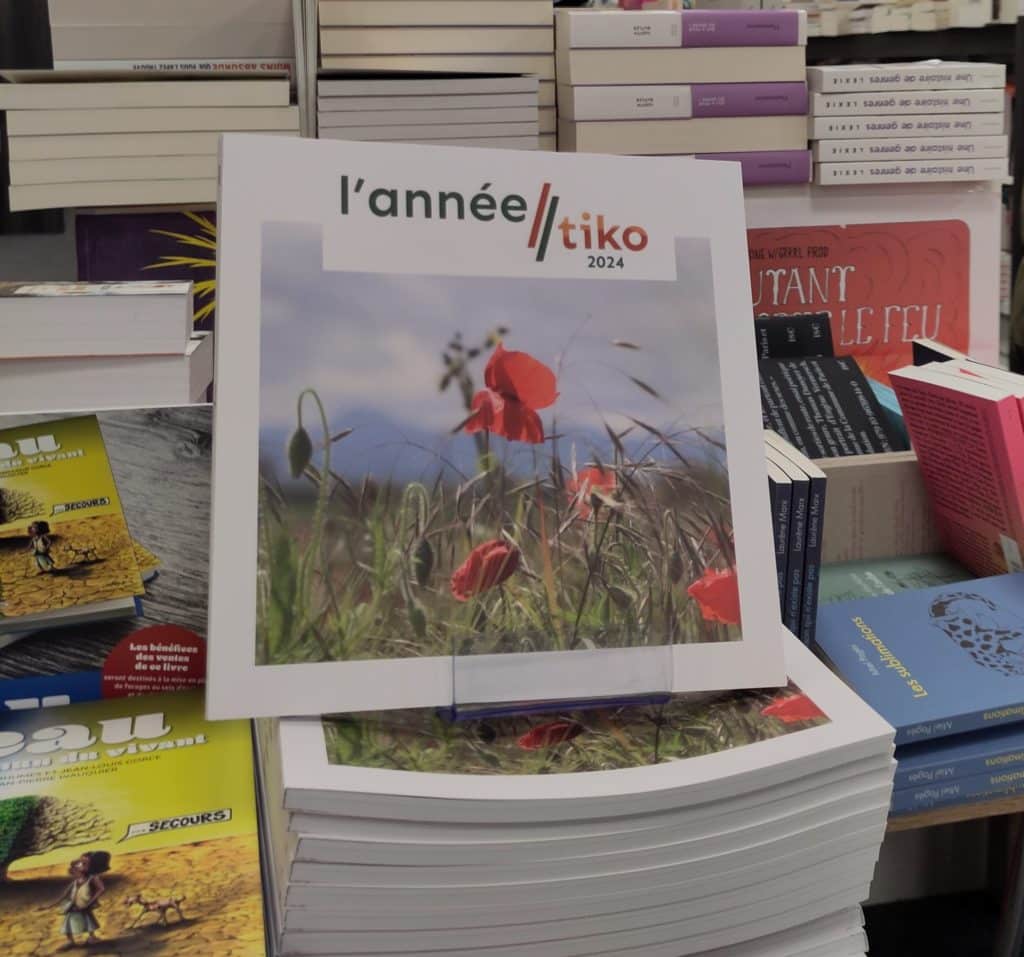Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]
Parfois, vous trouvez un petit fil qui dépasse, vous tirez dessus et c’est une pelote entière qui se dévide. Avez-vous déjà fait cette expérience ?
Quand Claire Mison a pris contact pour me proposer un sujet sur la gentiane, j’ai d’abord eu un petit réflexe de scepticisme : la boisson apéro la plus amère du monde, disponible dans les meilleurs supermarchés ou les pires, ne me semblait pas faire partie des besoins vitaux du territoire. Mais j’ai quand même dû pressentir le potentiel d’un petit fil à tirer.
Je lui ai demandé des précisions. Je me suis laissée convaincre de m’y intéresser.
Et là, entre Claire et Stéphanie avec leur savoir précis, leur enthousiasme intarissable et leur sens du récit, j’ai découvert un univers entier. Cet article est loin d’épuiser le sujet mais il vous en donne un bel aperçu.
Comme dit dans le reportage, il touche à la fois le social et l’économie, la culture locale et l’histoire, la tradition, le folklore et l’industrie, et bien sûr les équilibres à respecter, les problématiques de biodiversité, la fragilité des écosystèmes que nous malmenons, et le dérèglement climatique qui pointe le bout de son nez comme partout dès qu’on s’intéresse au vivant.
Il dit aussi la complexité des choses, et la nécessité de s’unir, par dessus les différences, pour affronter les crises. Une association qui réunit (entre autres) le petit cueilleur de plantes sauvages et le groupe Pernod-Ricard, VetAgroSup, Greentech, les deux copains d’enfance qui distillent L’Eau Folle en Tarentaise et l’auteur-éditeur suisse du bulletin « Gentiane Actualités », ça va dans le bon sens.
En tout cas il y avait là une super histoire à raconter et l’occasion d’une balade sous la neige d’avril. Vous allez voir qu’elles valent le détour.
Marie-Pierre
Trois infos express [cliquer pour dérouler]
- La gentiane jaune pousse dans les prairies d’altitude et a besoin d’être broutée par les vaches pour s’épanouir. Cette plante à rhizome a une croissance lente et met environ 20 ans à parvenir à la maturité. Elle est alors récoltée par des arracheurs, travail qui consiste à extraire la racine entière (et à remettre la motte en place). Cette racine est produite uniquement en France et majoritairement dans le Massif central. Elle est utilisée principalement dans la fabrication de liqueurs et eaux de vie, par quatre marques industrielles et divers petits producteurs. Réputée pour ses propriétés médicinales, notamment digestives et apéritives, elle trouve d’autres usages dans les compléments alimentaires, les cosmétiques, la pharmacie…
- Inquiète de la fragilité de la ressource, la filière s’est regroupée dans une association interprofessionnelle, animée par Stéphanie Flahaut, qui promeut une gestion durable de cet « or des montagnes ». La gentiane est affectée par le changement climatique, par des pratiques agricoles d’intensification et de déprise, mais aussi par des pratiques d’arrachage pas toujours respectueuses du cycle de vie de la plante, de l’état dans lequel elles laissent les prairies, ou de la main d’œuvre saisonnière employée.
- Paradoxalement, le maillon clef de la filière n’est pas un professionnel de la gentiane : c’est le propriétaire du pré. Il donne (ou non) l’autorisation d’arracher, décide de qui retourne la parcelle, quand, avec quelle méthode… Naturaliste et herboriste (entre autres), Claire Mison se propose d’aller à leur rencontre dans le cadre d’une enquête pour son diplôme d’ethnobotanique, en collaboration avec l’interprofession qui l’accueille en stage. Ce projet apportera un éclairage nouveau et complémentaire aux études réalisées, ouvrant un champ de travail dans l’univers complexe de ce système social et économique ancré dans une longue tradition.
« Ce qui m’a attirée, c’est que cette plante incarne l’identité d’un territoire et qu’elle résonne avec mes valeurs. D’abord parce qu’elle permet de sensibiliser à l’environnement, mais aussi parce qu’elle parle de ce qu’on voit et de ce qui est caché. Ce que les gens connaissent, ce sont les grandes tiges qu’on voit dans les prés avec leurs belles fleurs jaunes. Mais le vrai sujet, c’est la racine. D’un côté les apparences, de l’autre un produit lié à un territoire, la dureté d’un métier, les acteurs d’une filière, toute une économie… Dans la gentiane, il y a toute l’histoire du territoire », explique Claire Mison.
C’est ce que je suis venue comprendre en ce mercredi d’avril, sur les hauteurs qui entourent le lac du Guéry. J’ai pour guide Stéphanie Flahaut, animatrice de l’Association interprofessionnelle de la gentiane jaune, et Claire.
« Dans la gentiane, il y a toute l’histoire du territoire. »
C’est elle qui a piqué ma curiosité lors de nos premiers contacts en m’écrivant notamment que « documenter les pratiques des éleveurs, leur connaissance et leur perception de la gentiane jaune peut contribuer à une gestion durable de cette ressource naturelle locale. Ces savoirs, souvent fragmentés par métiers, générations et spécialités, sont essentiels pour garantir une exploitation respectueuse de l’environnement et éviter des dérives destructrices, en particulier quand la demande commerciale dépasse l’usage local. » Déjà tant de fils à tirer dans cette courte entrée en matière…

Après un parcours professionnel déjà long, dans l’agriculture bio, l’herboristerie, l’animation de groupes autour de la connaissance et de l’utilisation des plantes sauvages notamment, Claire Mison a trouvé sa voix en s’engageant dans des études d’ethnobotanique à l’Université de Grenoble. Elle a aussi trouvé, dit-elle, « le combat de ma vie, mon totem. »
Claire, comme Stéphanie, peuvent vous embarquer des heures à la découverte de cette plante qui ne vous évoque peut-être qu’un apéritif très amer commandé sur le coin d’un bar en ville ou apprécié entre copains au retour d’une rando. Mais avant de me la raconter, elles m’ont entraînée dans les prairies pour me la montrer.
Une sauvage en terrain agricole
Car c’est là où broutent les vaches à la belle saison qu’on les trouve. D’où cette première découverte : on pourrait dire, de façon un peu raccourcie, que la gentiane est inféodée au Saint-Nectaire, à moins que ce ne soit l’inverse. En tout cas en Auvergne, où ces deux joyaux du terroir s’épanouissent au-dessus de 800 m d’altitude.

En cette saison, la gentiane jaune (dont la sous-espèce locale est la Gentiana lutea lutea) n’est pas si facile à repérer. Et encore moins par ce temps de chien qui nous accompagne et qui est en train de virer à la neige. Car elle émerge à peine du sol, sous les herbes. Mais en se repérant à des tiges de l’été dernier et en écartant la végétation, Stéphanie repère facilement ces petites pousses claires, jouxtant des tiges encore plus anciennes qu’un bovin a dû trouver à son goût.
« Les moutons couperaient plus à ras et l’empêcheraient de repartir. »
Elle explique : « La gentiane est un rhizome qui se développe en souterrain, en rond ou parfois en croissant. Les vaches mangent les ‘endives’ en les coupant au-dessus du bourgeon, ce qui permet à la plante de développer de nouvelles tiges. Alors que les moutons couperaient plus à ras et l’empêcheraient de repartir. » C’est ce qui explique l’importance de l’élevage pour la gentiane : trop de végétation autre, un état de friche retournant peu à peu à un milieu boisé, et cette plante à la croissance très lente serait comme étouffée. Un défrichage trop sévère – par des fauches, des labours, des ovins… – et elle ne résisterait pas.
Car la gentiane a une durée de vie qui se rapproche plus de celle de l’humain que des herbettes qui l’entourent : une soixantaine d’années. Et arrive à maturité pour être récoltée à partir de 20 ans environ. C’est son paradoxe : celui d’une plante sauvage prospérant sur des terrains agricoles.

Panacée made in France
La deuxième chose à considérer, c’est ce que la plante offre d’intéressant pour les humains. C’est sa racine qui est convoitée, réputée pour ses vertus apéritives, digestives, toniques, anti-infectieuses, anti-dépressives… « Une panacée », résume Claire – entendez par là une plante qui, dans la pharmacopée traditionnelle, était censée guérir à peu près tout.
Aujourd’hui elle sert principalement pour préparer des liqueurs à base de racine macérée. On les connaît en France sous les étiquettes de quatre grandes marques qui les fabriquent à une échelle industrielle, et d’une poignée de petits fabricants locaux, comme l’Or en Cézallier produit par une rare éleveuse-arracheuse-liquoriste, ou la Génestine, très ancienne maison récemment ressuscitée à Clermont.

Le rhizome des pâturages a d’autres usages plus ou moins importants. Dans la catégorie alcools, on le transforme aussi en eau-de-vie, tradition plutôt alpine. Il est également utilisé en complément alimentaire, en médecine vétérinaire, depuis peu en cosmétique, anecdotiquement en parfumerie. Et des laboratoires au Japon et en Allemagne l’intègrent à des médicaments.
« On estime la production annuelle aujourd’hui à environ 2500 tonnes, dont 2000 dans le Massif central. »
Mais qu’elle soit transformée par Pernod-Ricard, Couderc, la petite fabrique artisanale de Saint-Donat, le labo de cosmétique de Saint-Beauzire Greentech ou dans la pharmacie japonaise, toute la gentiane commercialisée au monde vient de France. « Parce qu’elle est présente uniquement dans le sud de l’Europe, et très règlementée dans les autres pays de cette zone, où sa présence est plus fragile. En France, on la trouve dans tous les massifs. Mais il faut distinguer la plante sauvage, qui reste abondante, et la ressource exploitable : c’est-à-dire là où elle est accessible, suffisamment grosse et en densité suffisante. On estime la production annuelle aujourd’hui à environ 2500 tonnes, dont 2000 dans le Massif central », dépeint Stéphanie.

Traditions et usages
La répartition est aussi une affaire de règlementation. En vertu de l’annexe 5 de la Directive européenne Habitats faune-flore, sa protection est laissée à la libre appréciation de chaque État. En France, elle est laissée à la libre appréciation des préfets de chaque département. Et alors que son arrachage est limité ailleurs, elle ne fait l’objet d’aucune restriction dans le Massif central, sauf en Haute-Loire où elle est tout de même soumise à autorisation. Autrement dit, on peut quasiment l’exploiter à loisir chez nous… et on le fait.
À l’exception des zones protégées tout de même, de diverses restrictions possibles, et surtout d’un principe qui prolonge son statut de paradoxe sur pied : on ne l’arrache qu’avec l’accord du propriétaire de la parcelle, qui n’est très généralement pas l’arracheur ; et celui-ci devra verser un paiement à celui-là, du moins dans le Puy-de-Dôme. Ou au fermier qui exploite le terrain, comme c’est le cas dans le Cantal où l’on considère par défaut (sauf mention spécifiée dans le bail) qu’il est propriétaire des plantes.

On commence à entrevoir les complexités d’un univers où des traditions anciennes et territoriales ont façonné un modèle d’économie tout en subtilités et nuances locales, reposant sur des accords historiquement conclus à l’oral.
L’art de l’arrachage
Car entre la vache qui broute les feuilles, et la grande usine Suze (Pyrénées-Orientales) ou Avèze (à Riom-ès-Montagne), la filière intègre divers intermédiaires, dont ce maillon essentiel : l’arracheur – ou gentianaïre en patois local. L’étape est encore très artisanale et constitue, à l’échelle d’une parcelle, ce qu’on appelle « un chantier » : « L’arrachage, c’est plus qu’une simple cueillette », souligne Stéphanie.
« L’arrachage, c’est plus qu’une simple cueillette. »
Il faut y aller avec un instrument appelé « fourche du diable », que vous ne trouverez nulle part dans le commerce : pourvue d’un long manche et d’un marchepied permettant de la faire basculer, elle permet d’extraire la motte entière. « C’est délicat parce que la racine est cassante, explique Stéphanie. Une fois la motte retournée, l’arracheur l’ouvre à la main, en sort la gentiane, qui pèse 1 à 2 kg, et remet la motte en place. »
Vu le cycle de vie de la plante, la récolte se fait par rotation, une même parcelle n’étant exploitable que tous les 15, 20 ou 30 ans, le temps de se reconstituer avec les pieds laissés en place, le bouturage naturel des vieux rhizomes, et les graines répandues par grappes après la période de floraison estivale.

L’arracheur, c’est un individu ou une petite entreprise. Avec des pratiques qui peuvent être plus ou moins vertueuses, parfois très rigoureuses et respectueuses de la plante, des personnes, du renouvellement de la ressource ; parfois peu regardantes sur la façon de remettre les mottes en place, le respect des rotations longues, les conditions de travail et de rémunération des travailleurs saisonniers qui, comme dans d’autres spécialités agricoles, peuvent venir de l’étranger. « À l’échelle nationale, on estime à une dizaine les collecteurs entreprises et à une centaine les arracheurs individuels. Mais il n’y a pas de statut, donc c’est difficile de s’en faire une idée précise », poursuit Stéphanie.
La suite de votre article après une petite promo (pour Tikographie)

« les sols en danger, pourquoi et comment les protéger«
Notre prochaine table ronde réunira des intervenant.es puydômois.es autour de la question des sols sur notre territoire : importance pour la biodiversité, l’eau, le climat, l’agriculture… et comment les régénérer
49ème Rencontre Tikographie, mardi 6 mai 17-19h (au KAP) – tous publics, accès libre
Merci pour votre temps de cerveau disponible ! Le cours de votre article peut reprendre.
Besoin d’agir
C’est sur toutes ces questions que la filière a commencé à se réunir et à vouloir agir, d’abord sous l’impulsion de cueilleurs-arracheurs membres de la grande coopérative auvergnate de plantes aromatiques et médicinales, la Sicarappam. Nous sommes en 2010. « On entendait tout et son contraire sur l’état de la ressource. Le seul truc qui était sûr, c’est qu’on en prélevait beaucoup », résume Stéphanie. Les premières décisions ont été de créer une « mission gestion durable » et de la confier à un organisme qui en avait les compétences, le CPPARM ou Comité des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, basé en Provence et plus familier de la lavande que de la gentiane. Des fonds du Commissariat de Massif, principalement, ont soutenu et permis de pérenniser les actions.
« Le seul truc qui était sûr, c’est qu’on en prélevait beaucoup. »
C’est alors qu’est recrutée Stéphanie Flahaut, unique salariée du CPPARM à être basée en Auvergne, encore aujourd’hui, même si elle travaille désormais dans le cadre d’une mise à disposition pour l’Association interprofessionnelle de la gentiane jaune, créée entretemps, en 2014.
Son premier travail a consisté à élaborer un « Guide des bonnes pratiques », paru l’année suivante. « C’était l’urgence », dit son autrice.
Le climat s’en mêle
On trouve au fil de ces 16 pages des recommandations telles que : rédiger un contrat écrit entre le propriétaire et le gentianaïre ; respecter les règlementations et les dispositions locales ; espacer les arrachages de 20 ans sur un même site ; ne prélever que des gentianes « matures » et pas plus de 60 à 80% de la ressource sur une même parcelle… En résumé : assurer la durabilité et le renouvellement de cet or jaune des montagnes.
« Il y a eu une nette prise de conscience. »
Passons vite sur l’histoire de l’organisme, sur le projet finalement abandonné de créer une indication géographique protégée, sur le partenariat noué avec l’événement phare de la fête de la gentiane à Picherande, sur la création de divers groupes de travail, sur les études menées en partenariat avec VetAgroSup…
Et même sur les dissensions dans la filière, assez logiques vu le caractère très disparate des acteurs. Mais on retiendra que l’association poursuit un travail salutaire, ancré dans une triple mission : la sauvegarde de la ressource, la valorisation des produits et la représentation de la filière. Et qu’un consensus se dégage aujourd’hui au moins sur un point : « On est à un stade où les professionnels admettent tous qu’il y a un gros problème. Il y a dix ans, on n’en était pas là. Il y a eu une nette prise de conscience », souligne Stéphanie.

En cause, plusieurs types de pressions, à commencer par le dérèglement climatique, qui influe sur la germination, sur le comportement des brouteuses, sur le développement des plantes. L’abondance des prélèvements, qui n’a pas diminué dans ce contexte, a aussi sa part de responsabilité. Mais aussi l’évolution des pratiques agricoles, « souvent liée aussi à l’évolution du climat », explique encore la chargée de mission, qui cite les labours et les fauches pour tenter de régénérer les prairies, l’intensification ou au contraire la déprise agricole…
Le paradoxe de l’éleveur
C’est dans ce contexte que Claire Mison est arrivée avec son projet de réaliser une étude dans le cadre de son Diplôme universitaire, sur un sujet intitulé : « Enquête ethnobotanique sur la connaissance, la perception et la gestion de la gentiane jaune par les éleveurs sur la zone de l’AOP Saint-Nectaire ».
« J’avais envie de faire quelque chose qui valorise mon territoire. »
L’idée de travailler sur la gentiane, explique-t-elle, lui est venue « au détour d’une promenade à Picherande » où elle a été intriguée par le panneau « Village européen de la gentiane ». Ce qualificatif d’« européen » l’a amenée à se poser une série de questions, à se rendre à la fête de la gentiane, à y rencontrer des personnages clés de la filière, à cerner peu à peu le caractère emblématique, historique, social, économique de la plante et à confirmer l’intérêt de son sujet auprès de Stéphanie.

« J’avais envie de faire quelque chose qui valorise mon territoire et qui soit utile concrètement », dit Claire. L’utilité, c’est Stéphanie qui la précise : « Les éleveurs sont le premier maillon et le principal pilier de la gestion de la gentiane, car ce sont eux qui donnent accès, qui ont le pouvoir de contractualisation, qui choisissent la méthode d’arrachage… Mais paradoxalement ils ne sont pas des professionnels de la filière. Ils y ont leur place mais on manque de lien avec eux. L’étude va permettre de mieux comprendre leur vision et elle peut constituer une porte d’entrée pour aller à leur rencontre. »
Le périmètre du Saint-Nectaire, explique Claire, a été choisi parce qu’il colle à peu près à celui de la gentiane, contrairement aux autres AOP dont la zone est plus vaste et peut descendre à des altitudes où la plante n’est plus présente. « C’est la seule appellation fromagère en Auvergne dont le cahier des charges mentionne la présence de plantes sur les pâturages, sans qu’elle soit obligatoire : la gentiane y figure, avec le thym-serpolet, le fenouil des Alpes, l’achillée mille-feuilles et le trèfle des Alpes », explique-t-elle.
Une approche inédite
L’étude consistera à rencontrer et dérouler un questionnaire auprès d’un panel (modeste) d’éleveurs répartis sur toute la zone. Mais Claire espère que cette approche inédite de la gentiane ouvrira la voie à d’autres travaux. « Il n’y a pas de résultats attendus, précise-t-elle. On ne sait pas ce qu’on va trouver et ça va peut-être faire émerger des sujets… ou peut-être pas. »
« Elle est très représentative de ce qui constitue l’essence de cette filière : un équilibre entre la plante, l’animal et l’humain. »
« Ce qui serait déjà une donnée intéressante », complète Stéphanie, qui l’aide avec enthousiasme à valider son questionnaire. Car l’étude a pu trouver sa place dans le cadre d’un stage auprès de l’interprofession. « Claire est venue présenter le projet aux adhérents en janvier et ils ont été séduits, ajoute-t-elle. C’est une approche complémentaire à nos études qui permet un nouvel éclairage et ça peut constituer un projet pilote dont d’autres acteurs pourront aussi s’emparer : le parc des Volcans, l’AOP Saint-Nectaire, le tourisme… Elle est très représentative de ce qui constitue l’essence de cette filière : un équilibre entre la plante, l’animal et l’humain, qui sont interdépendants et se justifient mutuellement. »
Serait-ce cet équilibre insolite et délicat à préserver qui fait la saveur de la boisson emblématique de nos montagnes ? En tout cas, quelque chose me dit que si vous avez lu cet article jusqu’au bout, la prochaine fois que vous commanderez une gentiane au bistrot, vous la trouverez un peu moins amère…
| Pour en savoir plus sur l’Association interprofessionnelle de la gentiane jaune, consulter son site internet. Et sur les activités de Claire Mison, et notamment ses animations et sorties sur des thèmes autour des plantes, consultez le site internet Herbulathêkê |
| Infos supplémentaires : > La Fête de la Gentiane se déroule à Picherande chaque année, les 14 et 15 août. > Faut-il encore le rappeler ? Les alcools, même patrimoniaux, sont à consommer avec modération. |
Reportage Marie-Pierre Demarty, réalisé le mercredi 23 avril 2025. Photos Marie-Pierre Demarty, sauf indication contraire. À la une, photo Stéphanie Flahaut : gentianes jaunes en fleur dans un pré, sous le puy de Pailleret dans le Massif du Sancy
Soutenez Tikographie, média engagé à but non lucratif
Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.
Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien : de l’adhésion à l’association à l’achat d’un recueil d’articles, il y a six façons d’aider à ce média à perdurer :
La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail
Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?
Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.